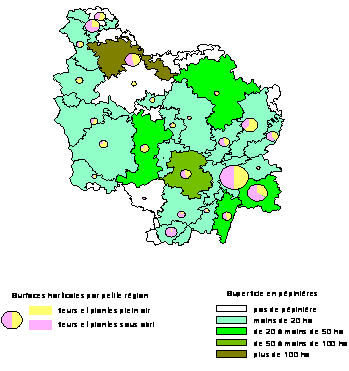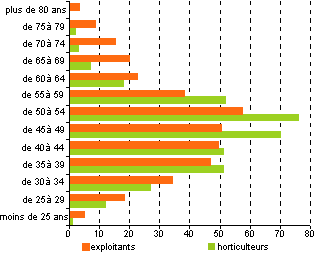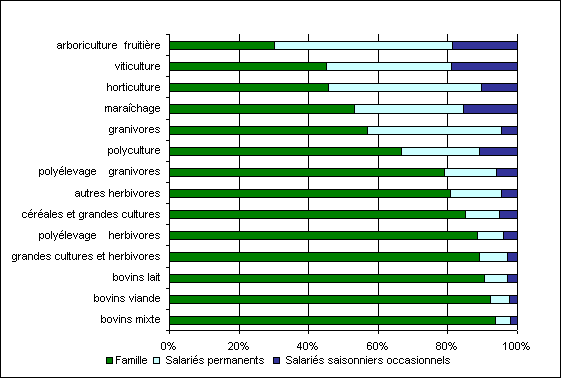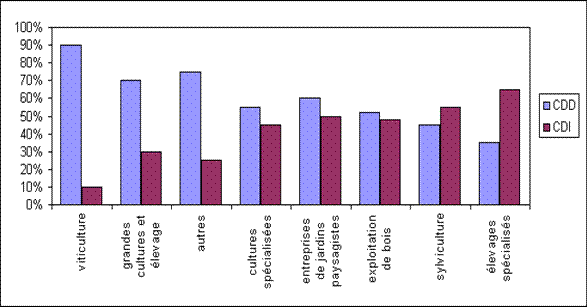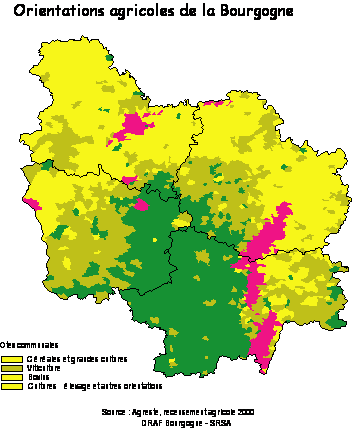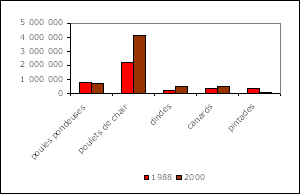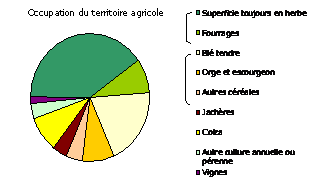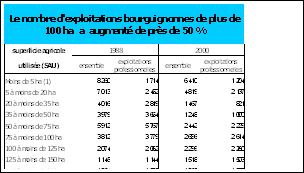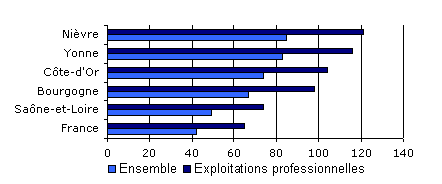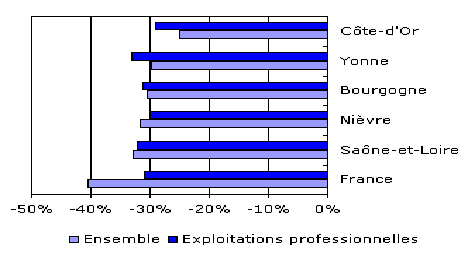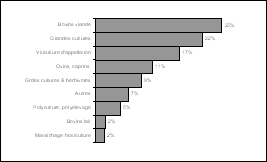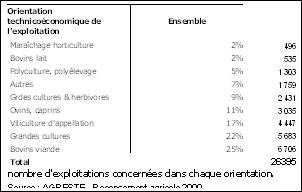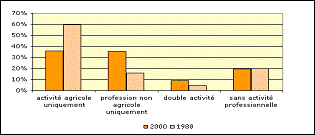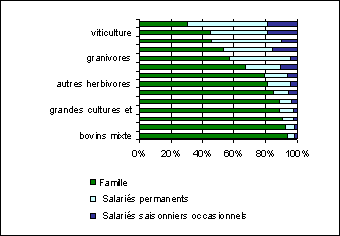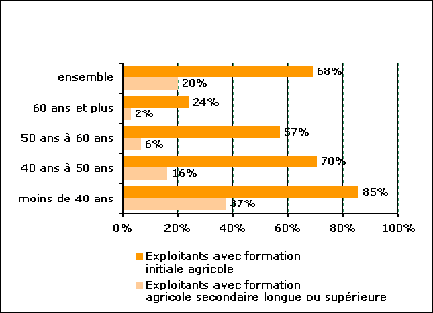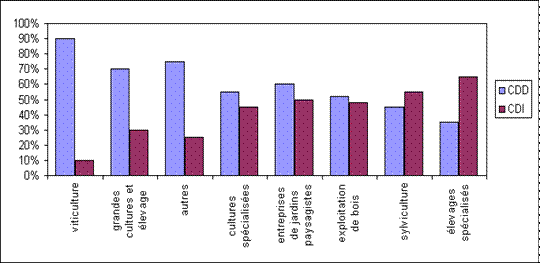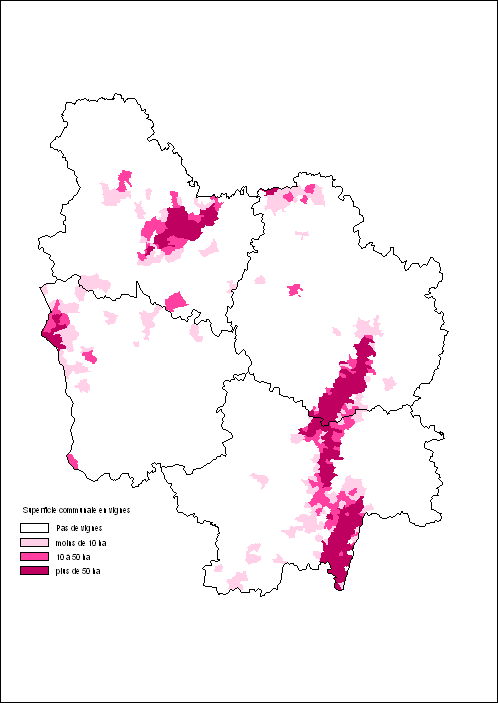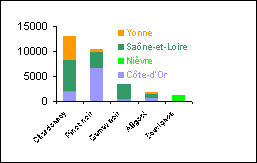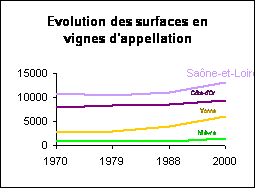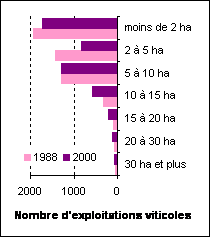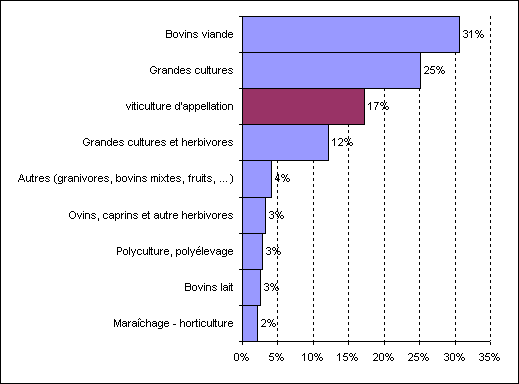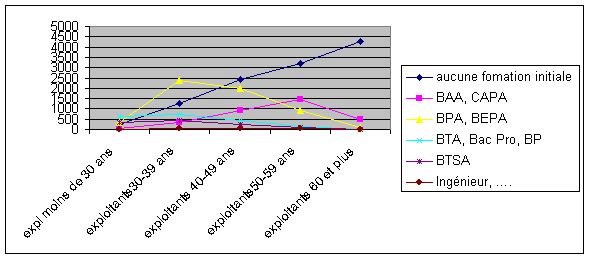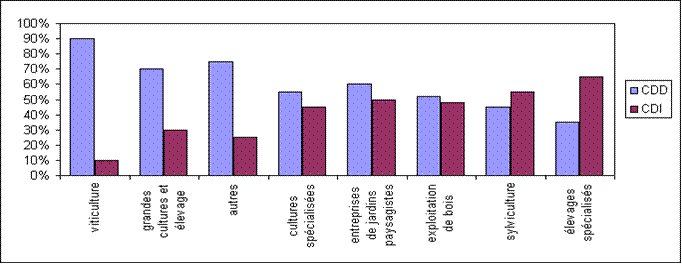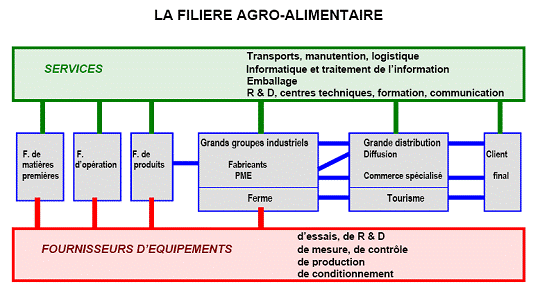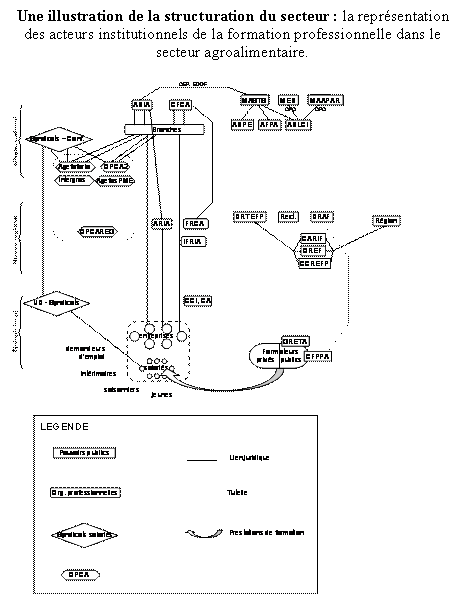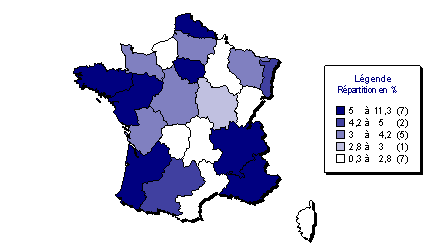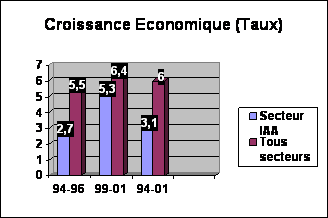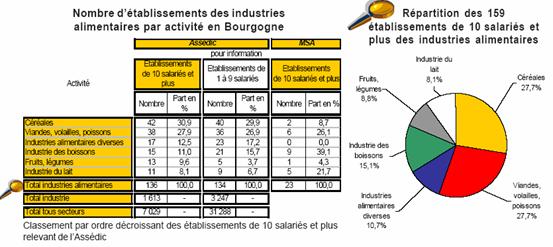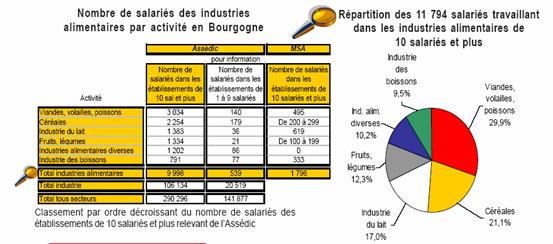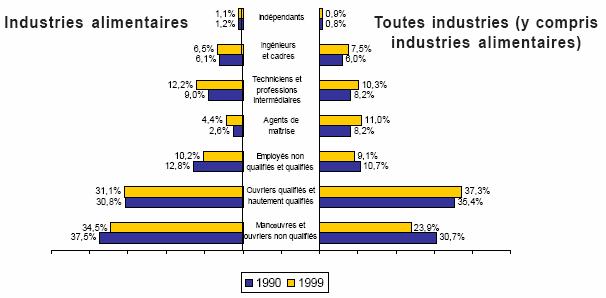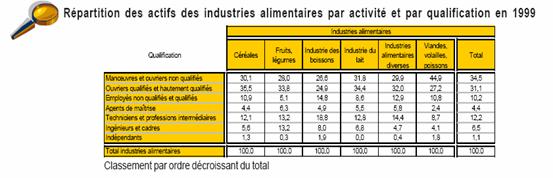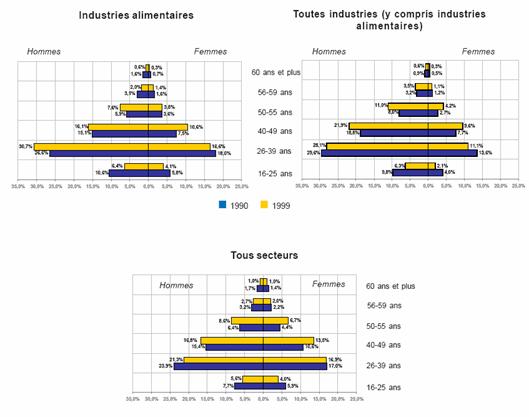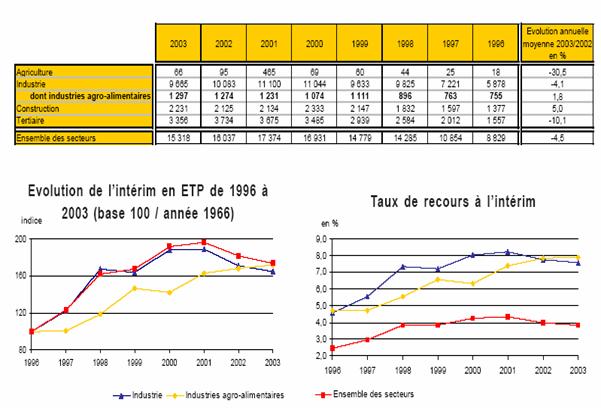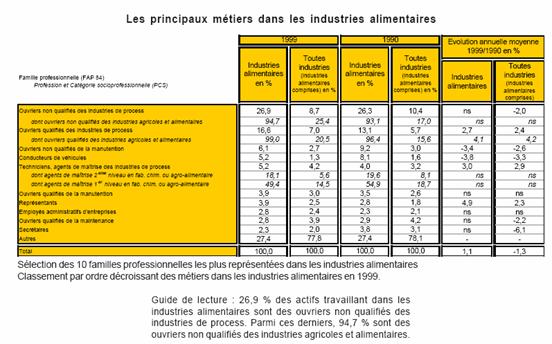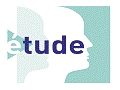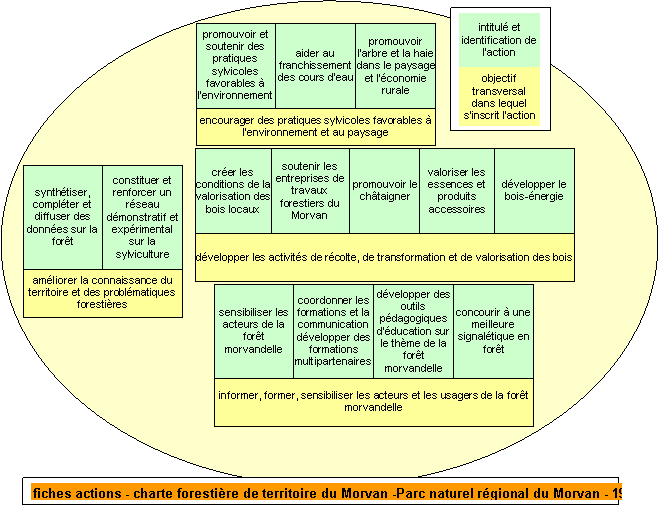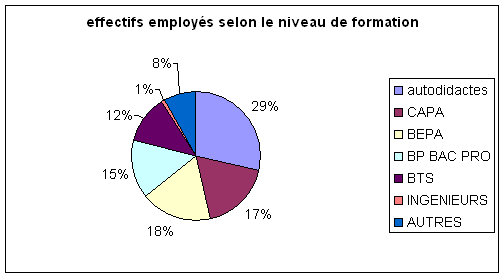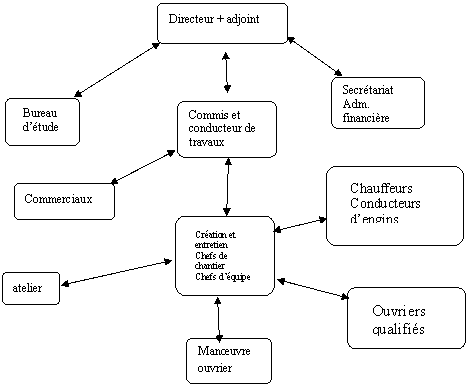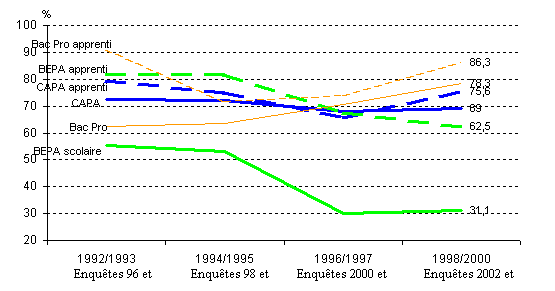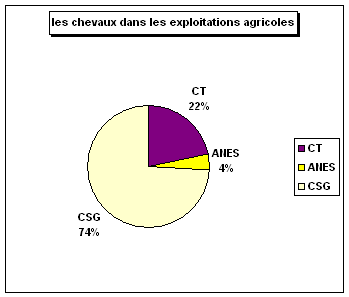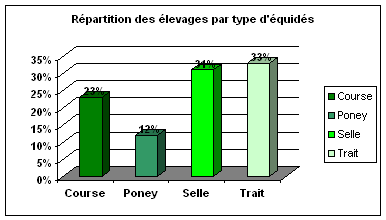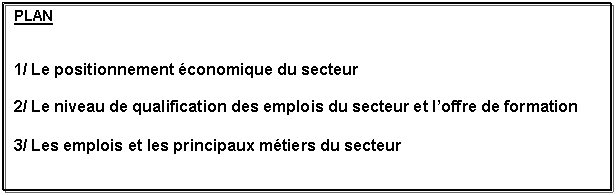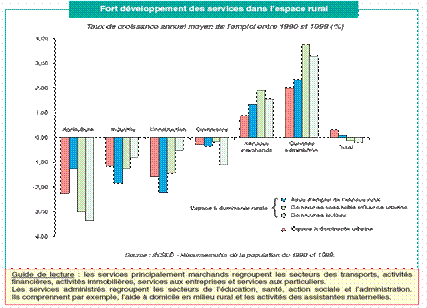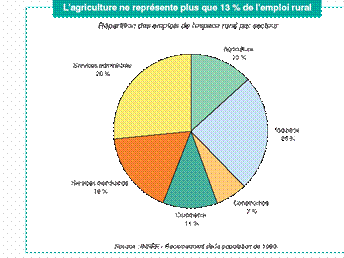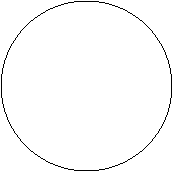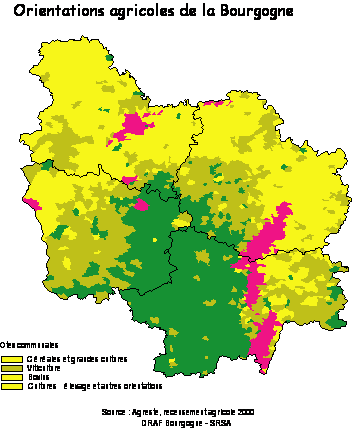
?IDEES-FORCES
·
La Bourgogne est une région agricole : l’agriculture
représente 5 ,1% du PIB régional, alors que cette activité ne contribue
qu’à hauteur de 2,4% du PIB national.
·
L’agriculture bourguignonne se spécialise et se concentre entre 1 :
o
l’élevage bovin viande,
o
les grandes cultures,
o
la viticulture déterminent les spécialisations des exploitations,
o
les systèmes de production mixte se raréfient encore.
Le cheptel :
o
L’élevage allaitant :
·
incontournable élément de l’entretien des zones difficiles de l’espace
rural bourguignon , l’élevage allaitant continue une progression amorcée depuis
plusieurs décennies,
·
près de 40 % des élevages allaitants détiennent presque 70 % des
vaches,
·
la race charolaise domine dans les prairies bourguignonnes,
·
les vaches nourrices occupent le sud-ouest de la région.
o
l’élevage laitier :
·
Une vache sur huit est une vache laitière,
·
Bresse, Puisaye et plateaux bourguignons sont les principaux
territoires laitiers,
·
45% des vaches sont dans des étables de plus de 50 têtes.
o
l’élevage ovin :
·
majoritairement à l’herbe et dans l’ouest de la région, il est surtout
le fait de petits troupeaux.
o
L’élevage porcin :
·
2/3 de la production dans des ateliers de plus de 400 porcs,
·
8 % des ateliers élèvent plus de 40 % des truies,
·
le cheptel porcin se concentre dans les départements de
Saône-et-Loire et Yonne.
o
Les volailles :
·
le nombre de poulets de chair a presque doublé en 12 ans.
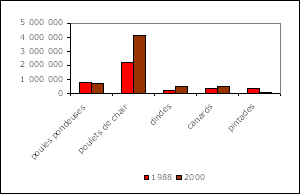
o
L’élevage caprin :
·
les petits élevages restent majoritaires.
·
les effectifs s’effondrent.
·
les chèvres sont surtout présentes à l’ouest et au sud est de la
Saône-et-Loire.
o
Chevaux : un regain d’activité,
·
près de quatre chevaux sur dix sont en Saône-et-Loire.
·
Les superficies agricoles
o
la prairie domine toujours mais perd du terrain au profit des
terres labourables dominées par le blé le colza l’orge betterave sucrière,
oignon, haricot vert. La surface fourragère occupe près de la moitié du
territoire agricole.
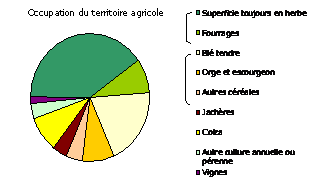
·
Des exploitations plus grandes
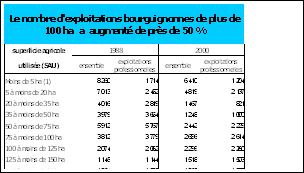
Les exploitations bourguignonnes ont une taille moyenne élevée
Taille moyenne des exploitations en ha
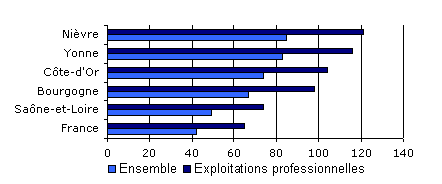
·
Plus de 70% des exploitations agricoles sont des exploitations
individuelles en 2000
·
La Bourgogne conserve mieux ses exploitations que la France
Evolution du nombre d’exploitations entre 1988 et 2000 en %1
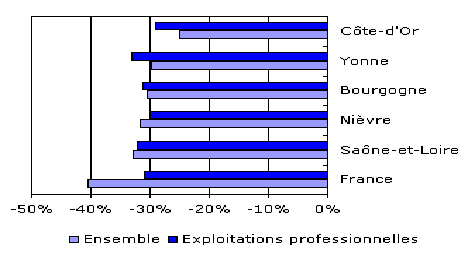
·
L’agriculture française à l’horizon 2015
Scénario 1 : l’adaptation de la PAC
Scénario 2 : l’ordre industriel
Scénario 3 : la qualité d’origine
Scénario 4 : l’agriculture de services
·
La diversification des activités dans les exploitations
bourguignonnes est essentiellement orientée sur la transformation des produits
à la ferme et à la vente directe au consommateur (le tourisme rural est peu agricole) .
·
Des exploitants plus jeunes conséquence de la généralisation
des mesures de départ en pré retraite : à partir de 55 ans beaucoup
d’exploitants quittent leur exploitation du fait de mesures incitatives au
départ anticipé.
·
18% seulement des exploitants urbains de 50 ans et plus ont une
succession assurée.
·
Orientation et nombre d’exploitations
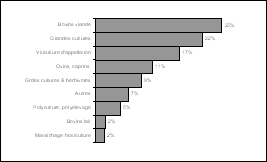
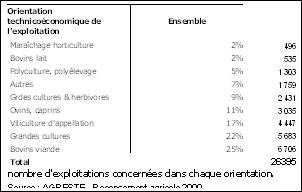
·
Les actifs familiaux
o
Le travail dans le secteur de la production reste familial mais
l’activité familiale chute quand même et ce en grande partie à cause du recul
de l’activité agricole des conjointes.
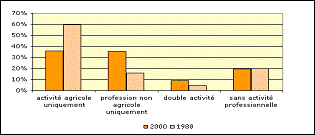
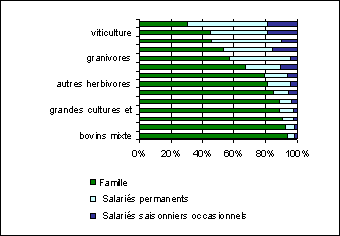
o
L’emploi agricole évolue vers plus de cogestion des
exploitations : plus de femmes
parmi les exploitants .
o
La majorité des jeunes qui s’installent privilégient la
forme sociétaire (CNASEA).
o
L’organisation du travail évolue : succès des SARL même si
63% des exploitations professionnelles ont un statut individuel.
o
Les groupements d’employeurs* et les services de remplacement
(MSA) : 215 groupements d’employeurs occupent en 2002 66 salariés en CDD
et 209 en CDI , 30 services de remplacement en 2002 emploient 283 salariés
en CDD et 66 en CDI.
o
45% des chefs d’exploitations se concentrent sur la
culture de céréales et les cultures industrielles.
·
Les salariés
o
Des salariés permanents : plus nombreux… :le
nombre des salariés permanents augmente entre 1988 et 2000 ; puis baisse
légèrement depuis 2000 L’emploi salarié agricole a progressé de 25 % en
2000 ;
o
La bourgogne est parmi les régions qui connaissent la plus forte
progression de l’emploi salarié dans l’agriculture entre 1988 et 2000.
o
Les salariés sont des jeunes : le salariat correspond
pour un certain nombre d’entre eux à une période d’attente de
l ‘installation. On constate une diminution du salariat pour les 36/ 40
ans signe d’un passage à l’installation.
o
Davantage à temps partiel: une majorité d’exploitants surtout en
grande culture emploie moins d’un ETP (MSA)conséquence
de l’augmentation de la taille des exploitations, et de la moindre participation
des actifs familiaux au travail agricole;
o
Les emplois de salariés permanents sont plus fréquents dans les
exploitations diversifiées (pour la transformation des produis agricoles, la
vente directe, le tourisme ou les travaux à façon).
·
La progression du salariat agricole ne compense pas la
disparition des emplois familiaux.
Evolution de l’emploi agricole de 1988 à
2000 en UTA
|
|
|
|
|
|
|
|
2000
|
1988
|
Evolution
1988 - 2000
|
|
Chefs d’exploitation
|
18 802
|
29 905
|
- 37%
|
|
Coexploitants
|
3 975
|
3 546
|
+ 12%
|
|
Chefs et coexploitants
|
22 777
|
33 451
|
- 32%
|
|
Conjoints actifs non coexploitants
|
4 712
|
10 563
|
- 55%
|
|
Autres actifs familiaux
|
2 082
|
4 957
|
- 58%
|
|
Actifs familiaux (UTA)
|
29 571
|
48 971
|
- 40%
|
|
Salariés permanents
|
6 751
|
5 451
|
+ 24%
|
|
Actifs permanents (UTA)
|
36 322
|
54 422
|
- 33%
|
|
Salariés saisonniers
|
3 274
|
2 567
|
+ 28%
|
|
Salariés des ETA - Cuma
|
183
|
208
|
- 12%
|
|
Ensemble des salariés
(UTA)
|
10 025
|
8 018
|
+ 25%
|
|
UTA totales
|
39 778
|
57 197
|
- 30%
|
|
|
|
|
|
|
Source : AGRESTE -
recensements agricoles 1988 et 2000
|
|
|
Les salariés agricoles en
Bourgogne
|
|
|
Source statistique :
recensement agricole 2000
|
|
|
|
ensemble
des exploitations
|
|
Exploitations
|
|
|
Exploitations employant des
:
|
|
|
- salariés permanents
uniquement
|
3 804
|
|
- salariés saisonniers ou
occasionnels uniquement
|
8 618
|
|
- salariés permanents ou
saisonniers ou occasionnels
|
10 246
|
|
ensemble des exploitations
|
26 395
|
|
Salariés permanents
|
|
|
dont hommes
|
6 777
|
|
dont femmes
|
1 626
|
|
ensemble
|
8 403
|
|
UTA salariés permanents
|
6 751
|
|
Qualification des salariés
permanents :
|
|
|
- cadre, contremaître, agent
de maîtrise
|
286
|
|
- technicien
|
241
|
|
- ouvrier agricole
|
7 876
|
|
Âge moyen des salariés
permanents
|
35,7 ans
|
|
- 1 salarié
|
2 388
|
|
- 2 salariés
|
1 296
|
|
- 3 et 4 salariés
|
1 430
|
|
- 5 salariés et plus
|
3 289
|
|
Temps d’activité des
salariés permanents :
|
|
|
- moins d’1/4 de temps
|
449
|
|
- ¼ de temps à moins du ½ de
temps
|
1 124
|
|
- ½ temps à moins de ¾ de
temps
|
1 278
|
|
- ¾ temps à moins d’un temps
complet
|
621
|
|
- temps complet
|
4 931
|
|
Salariés saisonniers ou
occasionnels
|
64 991
|
|
UTA salariés saisonniers ou
occasionnels
|
3 274
|
?IDEES-FORCES
·
La formation initiale agricole des chefs d’exploitation progresse.
|
|
1979
|
1988
|
2000
|
France 2000
|
|
sans formation
|
80.6
|
68.3
|
45.7
|
53
|
|
primaire
|
10.8
|
15.1
|
13.7
|
10.6
|
|
secondaire courte
|
6.8
|
12.1
|
25.4
|
22.4
|
|
secondaire longue
|
1.1
|
2.8
|
9.3
|
8.4
|
|
supérieure
|
0.7
|
1.7
|
5.9
|
5.6
|
·
La majorité des jeunes s’installent avec un diplôme au moins
équivalent au BAC sur de grandes exploitations traditionnelles de la Bourgogne
(CNASEA).
·
Les chefs d’exploitation « urbains » ont une formation
générale plus poussée :
o
19% d’entre eux ont continué cette filière après la troisième,
o
contre 12% des ruraux,
o
a contrario ils sont plus nombreux à n’avoir aucune formation
agricole :56% contre 46% pour les autres exploitants5 .
·
Plus de 80 % des jeunes exploitants professionnels de moins de 40
ans ont reçu une formation initiale agricole.
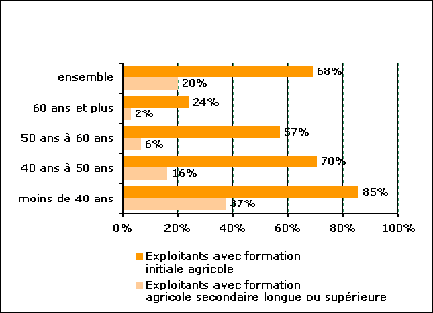
Source : AGRESTE - Recensement agricole 2000
·
Peu d’exploitants professionnels suivent un stage de formation
continue5.
|
SBUSEXP
|
SBUFPAP
|
Total exploitants professionnels
|
|
ENSEMBLE.
|
aucune
|
17193 79.2%
|
|
|
préparation installation (40
à 60 h)
|
1870 8.61%
|
|
|
stage court (20 à
120 h)
|
833 3.8%
|
|
|
stage autre
|
970 4.5%
|
|
|
BPA adulte
|
428 1.97%
|
|
|
BTA bac pro
brevet pro adulte
|
274 1.26%
|
|
|
BTSA adulte
|
32 0.14%
|
|
|
certificat de spécialisation
|
96 0.44%
|
|
|
autres (ingénieur)
|
13 0.059%
|
|
|
ENSEMBLE..
|
21709 100%
|
|
|
|
|
L’accès
aux formations se développe d’abord pour les chefs d’exploitation et les
coexploitants
?IDEES-FORCES
Comparaison entre CDD et CDI par groupements d’OTEX
·
L’insertion professionnelle des apprentis en février 2003, sept
mois après la fin de leur contrat :
après une formation en agriculture,
o
65 % des actifs issus de l’apprentissage ont un emploi salarié
dont 36% à durée indéterminée
pour
un salaire net médian de 1000 euros,
o
29% restent dans l’entreprise d’apprentissage et
o
22% sont au chômage en février 2003,
o
73% travaillent dans leur secteur de formation, l’agriculture et
souvent dans de petits établissements : la situation apparaît proche de la
moyenne des sortants de l’apprentissage.
·
L’agriculture en Bourgogne perd des emplois, mais cette baisse
est plus faible qu’au niveau national (INSEE) évolution 1988 20001.
·
Un emploi sur quatre se situe dans une exploitation périurbaine.
·
L’APECITA (public cadres) précise que la concurrence est faible
pour les emplois en grande culture :
o
26 candidats pour 10 offres en moyenne (données nationales)
o
Le niveau demandé par les employeurs :BAC+2
o
Les débutants sont acceptés à 67%
o
Pour travailler chez quels employeurs ?
§
48% en agrofourniture (industrie phytosanitaire…),
§
19% dans les OPA (ARVALIS chambre d’agriculture…),
§
14% dans les établissements publics et parapublics,
§
6% dans les exploitations agricoles grandes cultures polyculture
élevage,
§
6% dans les sociétés de commerce et de distribution,
§
(8% autres).
·
L’APECITA précise que la concurrence est faible pour les emplois
en élevage:
o
22 candidats pour 10 offres en moyenne (données nationales)
o
Le niveau demandé par les employeurs : BAC +2
o
Les débutants sont acceptés à 70%
o
Pour travailler chez quel employeur ?
§
24% en agrofourniture (industrie de l’alimentation animale
insémination…),
§
23% en OPA (contrôle laitier…),
§
17% en exploitation agricole (production animale, groupement
d’employeurs),
§
14% en société de commerce et distribution,
§
9% en établissement public et parapublic,
§
(12% en autres).
Participants :
Claude BERTHAUD (EPL Dijon-Quétigny)
Emmanuel BONNARDOT (Chambre d’agriculture 21)
Jean-Marc BROCHOT (DRAF-SRFD Bourgogne)
Patrice BRULEY (CFPPA Charolles)
Bernard CRETIN (CFA 71 site de Fontaines)
Dominique DEGUEURCE (DRAF-SRSA Bourgogne)
Claude DELAPORTE (Chambre d’agriculture 21)
Pierre DUBOIS (CPRE de Bourgogne – FDSEA 71)
Annie DUVIGNAUD (MFR Anzy le Duc)
Thérèse FAUVEAUX (LEAP de Louhans)
Jean-Louis GESUATI (DRAF-SRFD Bourgogne)
Hubert GOGLINS (EPL du Morvan)
Thierry HUBERT (MFR de Quétigny)
Pierre LACROIX (MFR Anzy le Duc)
Jean-Louis LALIGANT (MFR Liernais)
Jean-Pierre LEMOINE (DRAF-SRFD Bourgogne)
Marie-Jacqueline LISBERNEY (EPL Mâcon)
Martine MARCHAND (MSA)
Samuel MARECHAL (JA Bourgogne)
Michèle MICHEL (Chambre d’agriculture 71)
Jacques NERAND (MFR Etang sur Arroux)
Delphine PATEY (DRAF-SRFD Bourgogne)
Elizabeth PATHIER (MFR Villevallier)
Jean-Paul PERDREAU (DRAF-SRFD Bourgogne)
Catherine PICHON (Chambre d’agriculture 89)
François PONNELLE (Legta Semur-Châtillon)
Roger
ROUSSEL (EPL «Terres de l’Yonne»)
Nelly STEPHAN (APECITA)
Cécile TAVERNE (MFR Anzy le Duc)
Claudette TISSOT (Chambre d’agriculture 71)
Bernard TROUE (MFR de Villevallier)
René VOUILLOT (Legta Cosne-Plagny)
Lydia WEBER (EPL Dijon-Quétigny)
Rappel des principaux points abordés :
·
le contexte du PREAB : cadre institutionnel et réglementaire ;
calendrier de travail jusqu’en juillet 2005 (document remis )
·
présentation d’éléments d’information sur le secteur de la
polyculture-élevage ; grandes cultures
o
contexte régional ;
o
positionnement économique du secteur de la polyculture-élevage ;
grandes cultures ;
o
le niveau de qualification des emplois dans le domaine de la polyculture-élevage ;
grandes cultures ;
o
l’emploi et l’organisation du travail dans le domaine de la
polyculture-élevage ; grandes cultures ;
o
les emplois et les principaux métiers dans le secteur de la
polyculture-élevage ; grandes cultures
·
présentation de l’offre de formation et de son évolution entre
2001 et 2005 dans le secteur polyculture-élevage ; grandes cultures.
Objectif de cette réunion :
Débattre et échanger sur la
problématique « emploi-formation-qualification-compétences » dans le
secteur de la polyculture élevage et des grandes cultures en vue d’éclairer le
groupe de travail et le comité de pilotage du PREAB sur les principaux constats
à effectuer et sur les principales orientations à prendre par l’enseignement
agricole de Bourgogne, dans ce secteur, entre 2005 et 2009, en termes :
- de métiers et emplois ;
- de niveaux de formation et de
qualification,
- de nombre de formés et
d’évolution complémentaires des voies de formation (initiale
scolaire ; initiale apprentissage ; formation professionnelle
continue) et de répartition territoriale de l’offre de formation sous ses
différents aspects
Constats :
Par
rapport au document d’informations remis au groupe de travail il convient de
nuancer, par territoire, l’évolution et la part de certains élevages, en
particulier caprins et laitiers ;
Tendance
à la spécialisation de l’agriculture y compris dans l’élevage
(bovins-viande, ovins, caprins, laitiers);
La
durabilité conditionnera de plus en plus l’organisation du travail et
l’évolution des pratiques culturales et d’élevage ;
Les
grandes cultures génèrent des métiers spécifiques et exigent des compétences
spécifiques (technicité spécifique);
Les
élevages deviennent de plus en plus importants et il y a une forte aspiration à
faire évoluer l’organisation du travail pour permettre à l’éleveur de tendre
vers une vie sociale « normale »
On
va vers une restructuration de l’élevage laitier ( PAC, mise aux normes) ;
Complémentarité
entre installation et salariat ;
Le
nombre de salariés permanents est en augmentation ;
L’emploi
salarié devient de plus en plus un tremplin pour l’installation ;
Le
salariat peut être un objectif unique ;
Le
salariat agricole a changé ; les niveaux exigés sont plus élevés ;
les chefs d’exploitation acceptent plus facilement des salariés aussi voire
plus formés qu’eux ;
Peu
de contrats à temps partiel dans l’agriculture – élevage ;
Augmentation
du nombre de groupements d’employeurs ;
Des
groupements d’employeurs avec différents secteurs d’activités se créent pour
favoriser l’emploi permanent ( exemple : 1 groupement avec 1
maraîcher , 1 viticulteur, 1 entreprise de l’agroalimentaire) ;
Orientations à prendre :
Poursuivre
la promotion des métiers ;
Renforcer
la place de la formation dans la promotion des métiers ;
Faire
connaître les métiers ;
Renforcer
le travail auprès des prescripteurs : CIO, collèges…
Renforcer
le suivi de l’insertion ; travailler à des outils plus performants et
partagés pour le suivi de l’insertion ;
« vendre »
l’emploi salarié ;
augmenter
le nombre de jeunes filles dans les formations ;
Constats :
L’augmentation
de la taille des élevages, la concentration de la production, entraînent une
évolution de l’organisation du travail et exige une augmentation du niveau de
qualification ;
Les
grandes cultures génèrent des métiers spécifiques et exigent des compétences
spécifiques (technicité spécifique);
Complémentarité
entre installation et salariat ;
Le
nombre de salariés permanents est en augmentation ;
L’emploi
salarié devient de plus en plus un tremplin pour l’installation ;
Le
salariat peut être un objectif unique ;
Les
jeunes ont tendance à rester plus longtemps salariés avant
l’installation ;
Le
salariat agricole a changé ; les niveaux exigés sont plus élevés ;
les chefs d’exploitation acceptent plus facilement des salariés aussi voire
plus formés qu’eux ;
Le
BEPA est de plus en plus perçu comme une poursuite d’études malgré les difficultés
de certains jeunes dans ces sections ;
Le
bac professionnel est un bon diplôme ; les bacs profs s’insèrent très
facilement ;
On
sent un transfert et un glissement du bac prof vers le BTS ;
On
sent un frémissement dans l’emploi de cadres dans certaines
exploitations ;
Retard
de la Bourgogne en matière de licence professionnelle : faut-il ce niveau
pour les futurs exploitants ?
Orientations à prendre :
Augmenter
le nombre de bacs professionnels ;
Renforcer
le niveau du BEPA en améliorant la qualité du recrutement ;
Renforcer
les compétences centrées sur le raisonnement économique ;
Renforcer
les compétences centrées sur l’utilisation des nouvelles technologies ;
Travailler à une carte régionale de l’offre de formation
des MAR
Renforcer la présence en entreprise pendant la
formation ;
Travailler avec la profession sur la définition des
besoins qualitatifs en salariés ( quels salariés veut la profession
demain ?) ;
Maintenir le CAPA comme première marche d’accès à la
qualification ;
Lier
évolution de l’agriculture avec évolution du niveau de formation et privilégier
le niveau IV et le niveau III ;
Le point sur les effectifs en
2004 /2005 :
|
dpt
|
Type de formation
|
CAPA
PAUM
|
BEPA
CPA
|
BAC PRO CGEA
|
BTSA :
ACSE,
PA,PV
|
BPA
2003
|
BP REA
2003
|
CCTAR
|
Licence
prof
|
|
21
|
FIS public
|
|
37
|
43
|
49
|
|
|
|
|
|
FIS privé
|
|
51
|
13
|
|
|
|
|
|
|
App public
|
17
|
27
|
|
|
|
16 app
|
|
|
|
App prive
|
|
|
|
|
|
|
15 app
|
|
|
FPC public
|
|
|
|
|
799 hs
|
24807 hs
|
|
|
|
FPC privé
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dpt
|
Type de formation
|
CAPA
PAUM
|
BEPA
|
BAC PRO CGEA
|
BTSA :
ACSE,
PA,PV
|
BPA
|
BP REA
|
CCTAR
|
Licence prof
|
|
58
|
FIS public
|
|
84
|
47
|
91
|
|
|
|
|
|
FIS privé
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
App public
|
25
|
12
|
21
|
|
|
28 app
|
|
|
|
App prive
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FPC public
|
|
|
|
|
399 hs
|
11062hs
|
|
|
|
FPC privé
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dpt
|
Type de formation
|
CAPA
PAUM
|
BEPA
|
BAC PRO CGEA
|
BTSA :
ACSE,
PA,PV
|
BPA
|
BP REA
|
CCTAR
|
Licence prof
|
|
71
|
FIS public
|
|
92
|
|
66
|
|
|
|
|
|
FIS privé
|
|
106
|
22
|
|
|
|
|
|
|
App public
|
23
|
27
|
109
|
66
|
|
33 app
|
|
|
|
App prive
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FPC public
|
|
|
|
|
3128 hs
|
37679
hs
|
|
|
|
FPC privé
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dpt
|
Type de formation
|
CAPA
PAUM
|
BEPA
|
BAC PRO CGEA
|
BTSA :
ACSE,
PA,PV
|
BPA
|
BP REA
|
CCTAR
|
Licence prof
|
|
89
|
FIS public
|
|
26
|
42
|
68
|
|
|
|
|
|
FIS privé
|
|
24
|
21
|
|
|
|
|
|
|
App public
|
17
|
11
|
|
|
|
32 app
|
|
|
|
App prive
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FPC public
|
|
|
|
|
3747 hs
|
7424
hs
|
|
|
|
FPC privé
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Constats :
Le
problème n’est pas d’ouvrir des filières mais de les remplir ;
Sommes-nous
en avance ou en retard sur ce que nous devons sortir comme flux ?
(faire
le point avec les données du C2R dans le cadre de l’observatoire des
métiers) ;
le
problème de la mobilité subsiste ;
les
jeunes semblent attirés par l’apprentissage pour poursuivre un cycle de
formation ( BTS après bac prof par exemple) ;
Orientations à prendre :
Ne
pas être réducteur dans nos ambitions ;
Mettre
en parallèle les flux de diplômés et les flux d’actifs et voir s’il faut
reconsidérer le dispositif ;
Prendre
en compte le territoire ;
Renforcer
les dispositifs de FPC complémentaires aux formations diplômantes existantes ;
Faut-il
favoriser les fins de cycle en apprentissage ?
PREAB 2005/2009
PLAN
1/ Le positionnement
économique du secteur
2/ L’emploi et
l’organisation du travail dans le secteur
3/ Le niveau de qualification
des emplois du secteur
4/
Les emplois et les principaux métiers du secteur
Quelques précisions :
La réflexion sur le secteur de référence, implique de préciser:
ü
Une exploitation agricole est une unité économique ayant une
gestion indépendante et qui répond à un critère de dimension. Pour la vigne,
les critères sont 10 ares de vigne AOC ou 20 ares de vigne à vin de pays ou de
consommation courante.
ü
L’exploitation est professionnelle quand le travail agricole est
équivalent à 0.75 UTA soit une personne occupée à ¾ de temps dans une année, et
que sa dimension économique représente en Bourgogne l’équivalent de 12.8 ha de
blé ou 56 ares de vignes d’appellation.
ü
L’exploitation est spécialisée en viticulture quand cette production
représente les deux tiers ou plus de son chiffre d’affaires.
ü
47% des exploitations se situent en Saône et Loire, 35% en Côte
d’Or, 14% dans l’Yonne et 3% dans la Nièvre.
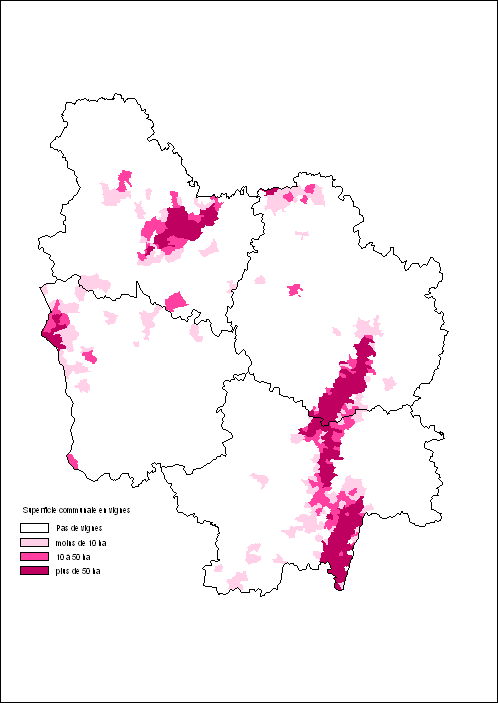
?IDEES-FORCES//
·
Le contexte général: La
viticulture française se trouve face à plusieurs difficultés, contraintes et
exigences :
o une baisse de la consommation intérieure. Dans ce
contexte, la capacité des vignobles à exporter est de plus en plus déterminante
mais elle doit se développer dans un marché mondial caractérisé par une
surproduction;
o une évolution de la demande vers des produits de
qualité, concomitante avec un développement de la consommation occasionnelle partout
dans le monde;
o les vins français sont confrontés à la concurrence
des « nouveaux pays viticoles »;
o une influence croissante de l’aval : le marché
conditionne de plus en plus la production.
·
Les exportations en Bourgogne
atteignent 54% des vins commercialisés, cependant une concurrence accrue de
pays tiers ou d’autres régions françaises inquiète les producteurs de
l’appellation régionale. Ils subissent des coûts de production élevés et se
placent moins bien sur un marché de plus en plus tendu.La commercialisation en
dehors des ventes directes est assurée par 120 négociants éleveurs et une
vingtaine de coopératives.
·
Dans ce contexte, l’entreprise
viticole doit s’inscrire de façon relativement précise dans un projet stratégique.
·
La réglementation dans le
domaine de la protection de l’environnement et l’évolution de la demande des
consommateurs conduit à la mise en place de nouvelles pratiques (lutte
raisonnée…). Les procédures qualité et de traçabilité (HACCP, iso…) conduisent
les entreprises à revoir l’organisation du travail et à moderniser certains
équipements.
·
En Bourgogne, la vigne est
cultivée sur près de 30000 ha pour produire des vins de Bourgogne, mais aussi
du Beaujolais, des vins du Val de Loire et des vins de pays.
·
La vigne est cultivée sur 1.7%
de la surface agricole de la région alors que la viticulture représente près de
30% de la valeur de la production agricole régionale.
·
Dans la région, 4816
exploitations viticoles commercialisent le produit de leurs vignes ou le
livrent à une coopérative.
Parmi elles, 2981 exploitations
professionnelles spécialisées en viticulture d’appellation (8.2% des
exploitations françaises) mettent en valeur 90% des surfaces.
·
80% du vignoble est en
chardonnay ou pinot noir.
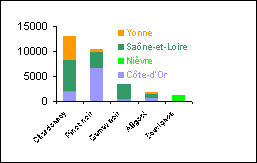
·
D’autres cultures sont
pratiquées par un certain nombre d’exploitations : 12%
Des exploitations cultivent des céréales, 6% des
oléagineux, 1/5 ont une superficie fourragère principale dont la taille moyenne
est de 11 ha. Une faible proportion des exploitations spécialisées en
viticulture d’appellation pratiquent de l’élevage.
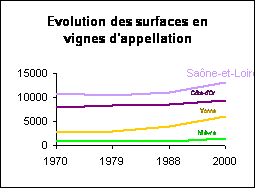
·
Ces exploitations se
caractérisent par une surface plus petite que la moyenne nationale. En
Bourgogne, 83% des exploitations ont une SAU inférieure à 20ha, contre 71% au
niveau national.
·
Les surfaces en vignes ont
augmenté. La surface moyenne en vigne par exploitation bourguignonne est passée
de 4.7 ha à 6.2 ha en 12 ans.
·
Le nombre d’exploitations
viticoles a diminué de 7% en 12ans. La concentration s’est faite au profit des
exploitations les plus grandes.
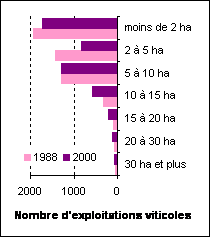
Orientation
technico-économique des exploitations professionnelles
Nombre
d’exploitations concernées dans chaque orientation
RGA 2000
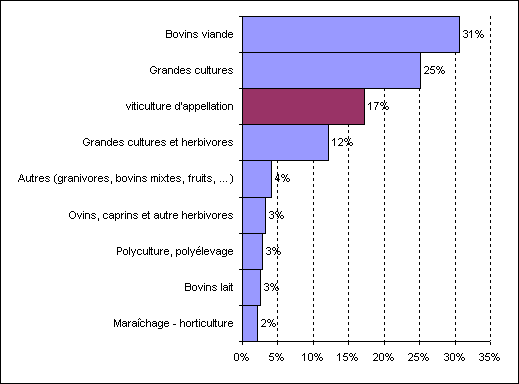
Niveau de
formation / âge des exploitants viticoles en Bourgogne
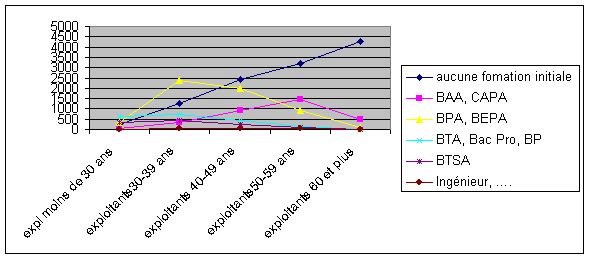
·
Les principales formations
diplômantes (au niveau national) en production :
o
niveau V :
§
CAPA « vigne et vin »
§
BEPA « conduite de productions agricoles ; spécialité
vigne et vin »
§
BPA par UC « chef d’exploitation ou ouvrier hautement
qualifié en viticulture »
o
niveau IV :
§
BAC PRO CGEA vigne et vin
§
BP par UC « responsable d’exploitation agricole spécialité
cultures pérenne »s
o
niveau III :
§
BTSA viticulture œnologie
o
niveau I :
§
DNO
·
Les principales formations
diplômantes en commercialisation :
o
niveau IV :
§
BAC PRO technicien vente et conseil qualité en vins spiritueux
o
niveau III :
§
BTSA TC BVS
o
niveau II :
§
licence professionnelle « commerce et distribution des
produits vinicoles »
·
qualification de branche :
§
CQP « ouvrier qualifié de l’exploitation viticole »
?IDEES-FORCES/
·
Les exploitants, du fait des
nombreux départs en retraite, sont en proportion plus jeunes en 2000 qu’en
1988. Il y a nettement moins de 55 ans ou plus, la part des moins de 40 ans n’a
pas bougé, celle des 40/54 ans est passée de 31% à 45%; La proportion des moins
de 40 ans est plus forte en Bourgogne qu’en moyenne nationale.
·
46% des viticulteurs
professionnels exploitent en société en 2000 alors qu’ils n’étaient que 17% en
1988.
·
En 2000 , 45 viticulteurs
avaient intégré la filière de l’agriculture biologique.
·
46% des viticulteurs
professionnels exploitent en société en 2000 alors qu’ils n’étaient que 17% en
1988.
·
Les exploitations viticoles
utilisent, à l’échelon national, y compris le travail saisonnier et
occasionnel, l’équivalent de 1.7 personne occupée à temps plein soit 0.3 de
plus que l’ensemble des exploitations agricoles.
·
Le secteur viticole, au niveau
national, emploie de la main d’œuvre qui travaille :
o à temps plein : 10 .5%
o à temps partiel :7.5%
o de façon saisonnière : 82%.
·
Les salariés : La participation des salariés au travail total
effectué sur les exploitations est devenue majoritaire, le travail repose à 55%
sur les salariés (36% pour les salariés permanents, 19% pour les salariés saisonniers.
·
La culture de la vigne
d’appellation demande beaucoup de main-d’œuvre, en 2000, les exploitations
viticoles de Bourgogne ont occupé l’équivalent de 30% des emplois agricoles de
la région dans un secteur qui ne représente que 18% des exploitations.
·
La part d’emplois salariés
atteint 62% dans les exploitations viticoles professionnelles spécialisées en
viticulture.
·
58% des salariés permanents et
65% des saisonniers de l’agriculture travaillent dans les exploitations
viticoles.
·
Dans ce secteur l’emploi total a
progressé de 4% en 12 ans, l’emploi des salariés permanents de 52% et l’emploi
des salariés saisonniers de 40%.
·
Sur la même période, les
surfaces vendangées à la machine ont plus que doublé (près de la moitié des
surfaces ont été vendangées à la machine en 2000).
|
Proportion de la qualification des salariés
permanents viticoles en 2000 (en %)
|
|
|
CADRE
|
TECHNICIEN
|
OUVRIER
|
|
|
Champagne Ardennes
|
4
|
3
|
93
|
|
|
Centre
|
3
|
4,3
|
92,7
|
|
|
Bourgogne
|
2,8
|
2,4
|
94,8
|
|
|
Alsace
|
8,5
|
4
|
87,5
|
|
|
Pays de la Loire
|
5,4
|
6,1
|
88,5
|
|
|
Poitou Charente
|
3,7
|
1,6
|
94,7
|
|
|
Aquitaine
|
6
|
3,4
|
90,7
|
|
|
Midi Pyrénées
|
9,3
|
5
|
85,6
|
|
|
Rhône Alpes
|
3,9
|
4,3
|
91,8
|
|
|
Languedoc Roussillon
|
10,5
|
3,4
|
86,1
|
|
|
PACA
|
9,2
|
8,9
|
81,9
|
|
|
Main d’œuvre des
exploitations viticoles en UTA
|
1988
|
2000
|
|
Chefs d’exploitations et
coexploitants
|
38.7
|
34
|
|
conjoints
|
|
|
16.4
|
8.9
|
|
autres actifs familiaux
|
|
|
5.5
|
3.3
|
|
total population
familiale
|
|
60.6
|
46.2
|
|
salariés permanents
|
|
|
24.9
|
34.7
|
|
salariés saisonniers et
occasionnels
|
14.4
|
18.8
|
|
salariés des ETA et des
CUMA
|
|
0.2
|
0.3
|
?IDEES-FORCES
Comparaison entre CDD et CDI par groupements d’OTEX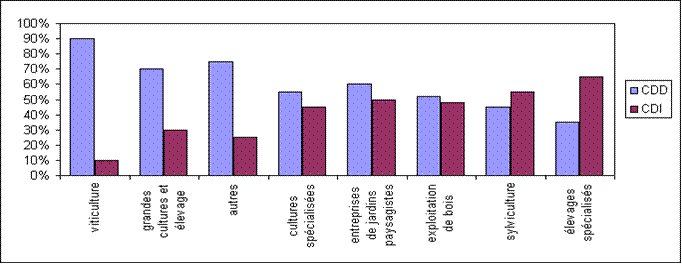
·
La modification de la conception
de la production viticole est un élément de contexte primordial qui a des
conséquences sur les compétences exigées, c’est le marché qui conditionne
l’amont, la production.
·
Cela se traduit par un
changement profond du cœur de métier:
o passage
du statut d’agriculteur à celui d’entrepreneur pour l’exploitant, avec gestion
des stocks, des salaires, des budgets, donc l’exploitant se dessaisit de la
fonction production et à tendance à déléguer cette fonction. Il s’agit pour lui
de développer des compétences stratégiques liées au domaine commercial, financier
et GRH.
o passage
d’un rôle d’exécutant à un rôle de raisonnement de la pratique pour l’ouvrier
viticole. Il réalise les travaux manuels de la vigne : la taille, le relevage,
le palissage, l’ébourgeonnage, les vendanges…
o l’ouvrier
de chai: réceptionne la vendange, assure le contrôle des fermentations, élève
le vin, participe aux opérations de conditionnement du vin, entretient le
matériel.
o le
vigneron tractoriste: le développement de la mécanisation, d’un matériel de
plus en plus sophistiqué technologiquement impose des compétences périphériques
à la filière: la maîtrise de la conduite et du réglage du matériel d’où
l’apparition du vigneron tractoriste.
o les
œnologues qui optimisent l’ensemble des étapes de la vinification au conditionnement,
en pratiquant un suivi par analyses et dégustations jouent le plus souvent le
rôle de maître de chai ou de chef de culture ((fonction de gestion,
d’organisation des travaux d’encadrement du personnel). Ils ont fait une
entrée massive dans les entreprises afin d’assurer une vinification de qualité.
o les
commerciaux : le développement de la commercialisation et de la vente directe
( avec nécessité de connaissances sur les aspects culturels autour du produit)
dans les entreprises viticoles amène les grandes structures à recruter des
commerciaux, (du personnel qualifié avec un certain degré d’autonomie).Dans les
petites unités, cette fonction est assurée le plus souvent par des personnes
occupées à la vigne ou au chai.
·
L’APECITA indique, au niveau
national, une faible concurrence au niveau du marché de l’emploi cadre :
22 candidats pour 10 offres en moyenne.
·
Les employeurs recherchent des
candidats BAC+ 2.
·
Les compétences directement
liées au produit sont les plus demandées :
o
viticulture, (62%des offres)
o
œnologie et commerce de vins et
spiritueux (58% des offres).
·
A titre secondaire, des
compétences en encadrement peuvent être souhaitées.
·
La Bourgogne est moins
pourvoyeuse d’emplois de cadres viticoles que Rhône Alpes ou PACA.
·
D’une région à l’autre, il
existe une plus ou moins grande pénurie d’emplois dans le secteur de la viticulture.
·
Les exploitants disent avoir des
difficultés à trouver des salariés compétents et motivés : problème de
l’image du salarié viticole, peut-être aussi un problème de rémunération et de
reconnaissance du travail. Plus globalement, il existe des problèmes de fidélisation
des salariés, d’attractivité des métiers et de recrutement de main-d’œuvre
qualifiée.
·
Bien que cela mérite d’être
nuancé d’une région à l’autre, l’intérim intervient de plus en plus dans
l’externalisation des ressources humaines.
·
Les candidats répondent sans mal
aux exigences en matière de compétences techniques en revanche ils sont peu
nombreux à proposer des compétences commerciales ou en encadrement.
·
Chez quels employeurs
travaillent les cadres ?
o
40% dans des exploitations
o
28% dans le négoce et le commerce de vins et spiritueux
o
11% dans les IAA
o
10% dans les OPA
·
Avec quelle expérience ?
o Les débutants sont acceptés à 51%
·
63% des contrats sont des CDI et
36% sont des CDD.
Participants
BALDASSINI Michel (Chambre Agriculture Saône-et-Loire)
BESANCENOT Bernard (CFA Beaune ; CA Côte d’Or)
BROCHOT Jean-Marc (DRAF SRFD Bourgogne)
CHARTREUX Valérie (LEGTA Nevers/Côsne)
CHAUDRON Patrick (MSA 21)
CLERC LAPREE Fabienne (CFPPA Mâcon Davayé)
DENIS Gilles (EPL Mâcon Davayé)
DORMOY Fleur (APECITA)
GANNE Jacques (MFR Grandchamp)
GATEAU Francis (EPL Beaune)
GESUATI Jean-Louis (DRAF SRFD)
GUILLEMOT Jean-Pierre (MFR Grandchamp)
GUYOT Marie-Paule (FAFSEA Bourgogne)
HAMELIN Thierry (CA Yonne)
LEBROT Estelle (CFPPA Beaune)
LOYAT François (VIVEA)
MANSOT Chantal (Chambre Agriculture Côte d’Or)
MIOLANE Patrick (MFR Grand Champ)
PATEY Delphine (DRAF SRFD)
PROST Jean-Luc (CFA/CFPPA Beaune)
ROY Alain (CA Saône-et-Loire)
THIBAUT Jean-Baptiste (CA Yonne)
VUITTENEZ Bruno (EPL Beaune)
VUITTENEZ Elisabeth (CFPPA Beaune)
WILLETTE Guillaume (Conf.des Assoc.viticoles de Bourgogne)
Rappel des principaux points abordés :
·
le contexte du PREAB :
cadre institutionnel et réglementaire ; calendrier de travail jusqu’en
juillet 2005 (document remis )
·
présentation d’éléments
d’information sur le secteur de la viticultures
o contexte régional ;
o positionnement économique du secteur de la viticulture
o le niveau de qualification des emplois dans le domaine
de la viticulture
o l’emploi et l’organisation du travail dans le domaine
de la viticulture
o les emplois et les principaux métiers dans le
secteur de la viticulture
·
présentation de l’offre de
formation et de son évolution entre 2001 et 2005 dans le secteur de la
viticulture.
Objectif de cette réunion :
Débattre et échanger sur la
problématique « emploi-formation-qualification-compétences » dans le
secteur « viticulture-œnologie » en vue d’éclairer le groupe de
travail et le comité de pilotage du PREAB sur les principaux constats à
effectuer et sur les principales orientations à prendre par l’enseignement
agricole de Bourgogne, dans ce secteur, entre 2005 et 2009, en termes :
- de métiers et emplois ;
- de niveaux de formation et de
qualification,
- de nombre de formés et
d’évolution complémentaires des voies de formation ( initiale
scolaire ; initiale apprentissage ; formation professionnelle
continue) et de répartition territoriale de l’offre de formation sous ses
différents aspects
Constats :
La notion de qualité concerne
tous les vins au-delà des AOC ;
L’agrandissement des
exploitations :
- rend l’installation des jeunes
de plus en plus difficile (en particulier pour les hors cadre familial),
- augmente les besoins en
salariés,
- accroît les exigences en
qualification de ces salariés entre autre sur les aspects liés aux agro-
équipements,
- entraîne l’externalisation de
certaines tâches ;
Nécessité de plus en plus
fréquente d’avoir, à l’interne, un second d’exploitation capable de suppléer
le chef d’exploitation ;
Une récente étude du centre de
gestion de 71 montre qu’en Mâconnais, les grosses exploitations (15ha et +)
s’en sortent mieux que les plus petites ;
L’image du métier n’est pas au
mieux ;
Difficultés accrues à renouveler
les actifs et à trouver de la main d’oeuvre qualifiée ;
Difficultés accrues pour attirer
des jeunes dans ce secteur d’activités ;
Trop de jeunes formés par
alternance ne restent pas dans le métier : pourquoi ? Comment mettre
en avant les débouchés de ce secteur ? comment améliorer les perspectives
de carrières ?
Evolution du métier
d’œnologue ;
On note une articulation
œnologue/chef de culture ;
La fonction d’œnologue est de
plus en plus externalisée ;
L’exploitation évolue ; la
commercialisation prend une part croissante ;
La dimension internationale du
commerce prend une part croissante ;
Contraintes de plus en plus
fortes concernant la traçabilité des produits ;
Contraintes de plus en plus
fortes concernant la protection de l’environnement
Valoriser les apports de
l’observatoire régional de l’emploi mis en place dans le cadre du contrat
d’objectif partenarial agricole (COPA)
Orientations à prendre :
Nécessité d’un travail fort sur la
valorisation du métier ;
Conforter la qualité en formation
initiale pour construire un socle solide de connaissances et d’acquisitions
théoriques et pratiques ;
Accompagner le développement des
compétences des salariés par la FC : exigence pour les centres de
formation pour adultes d’apporter des réponses en la matière ;
Renforcer les apports en matière
de gestion des ressources humaines et de gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences
Comment
valoriser l’espace européen pour trouver la main d’œuvre dont on a besoin ?
Constats :
Exigences croissantes en
polycompétences : vigne, cave, commercialisation ;
L’ouvrier doit avoir la double
compétence vigne-cave ;
Exigences de plus en plus fortes
concernant le respect des conditions d’hygiène et de prévention des risques
professionnels ;
Exigences de plus en plus forte
en matière de réglementation ;
Il en est de même du respect des
règles environnementales ;
Le diplôme du bac professionnel
semble adapté aux exigences de la polyvalence
Manque de sensibilisation et de
formation des chefs d’exploitation aux aspects liés à l’organisation du travail
des salariés et à la gestion des ressources humaines ;
Forte demande de la profession
sur le secteur de la conduite du matériel ;
Au sortir d’un BEPA un jeune
sait-il conduire un enjambeur ?
Difficultés pour les
établissements de formation de gérer les contraintes liées aux exigences et
aux risques de la conduite du tracteur-enjambeur ;
Attente de plus en plus exigentes
en matière de traçabilité des produits ;
Bon nombre de salariés des
exploitations ne sont pas qualifiés
Evolution du métier
d’œnologue ;
Orientations à prendre :
Améliorer les compétences en
agro-équipements spécifiques à la viticulture,
Renforcer les apports en
formation liés au respect des conditions d’hygiène et ceux liés à la
prévention des risques professionnels ;
Renforcer les apports en
formation liés au respect des règles environnementales.
Renforcer , pour les salariés ,
l’acquisition de compétences transversales ;
Former des tractoristes ayant des
capacités à travailler également en vigne et/ou en cave ;
Renforcer la formation des
exploitants en matière d’organisation du travail ;
Renforcer les apports liés à la
qualité des produits ;
Renforcer les modules spécialisés
sur la conduite de l’enjambeur en sécurité mais également sur l’utilisation des
différents équipements en cave ;
Prendre une orientation forte sur
la problématique de la sécurité et de la conduite ;
Renforcer la formation des exploitants
sur les aspects liés à la commercialisation ;
Renforcer les aspects managements
du personnel dans les formations BTS ;
Le point sur les effectifs 2004/2005 et heures-stagiaires 2003 (FPC)
|
Département
|
Type de formation
|
CAPA tonnelier
|
CAP vigne et vin
|
BEPA
|
BAC PROF
|
BTSA
|
BPA
2003
|
BP
2003
|
Licence prof
2003
|
|
21
|
FIS public
|
21
|
|
56
|
54
|
79
|
|
|
|
|
FIS privé
|
|
|
26
|
|
|
|
|
|
|
App public
|
|
25
|
29
|
23
|
32
|
|
|
|
|
App prive
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FPC public
|
|
|
|
|
|
21481 hs
|
7579 hs
|
|
|
FPC privé
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Département
|
Type de formation
|
CAPA tonnelier
|
CAPA
Vigne et vin
|
BEPA
|
BAC PROF
|
BTSA
|
BPA
|
BP
|
Licence prof
|
|
58
|
FIS public
|
|
|
17
|
23
|
|
|
|
|
|
FIS privé
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
App public
|
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
App prive
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FPC public
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FPC privé
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Département
|
Type de formation
|
CAPA tonnelier
|
CAPA
Vigne et vin
|
BEPA
|
BAC PROF
|
BTSA
|
BPA
|
BP
|
Licence prof
|
|
71
|
FIS public
|
|
|
18
|
21
|
38
|
|
|
|
|
FIS privé
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
App public
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
App prive
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FPC public
|
|
|
|
|
|
3364hs
|
17010hs
|
|
|
FPC privé
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Département
|
Type de formation
|
CAPA tonnelier
|
CAPA
Vigne et vin
|
BEPA
|
BAC PROF
|
BTSA
|
BPA
|
BP
|
Licence prof
|
|
89
|
FIS public
|
|
|
16
|
|
|
|
|
|
|
FIS privé
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
App public
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
App prive
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FPC public
|
|
|
|
|
|
4312 hs
|
|
|
|
FPC privé
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* licence
professionnelle « commerce et distribution des produits vinicoles à Beaune
et Mâcon (en partenariat avec l’IUT de Châlon / Saône.
Constats :
Des tensions sur le recrutement
dans tous les diplômes ;
Des difficultés de recrutement
plus fortes sur Davayé ;
Besoin de main d’œuvre
qualifiée ;
Le parcours BEPA-bac prof
fonctionne ;
Le bac professionnel et le BTSA
sont des diplômes à promouvoir ;
Orientations à prendre :
Chercher à renforcer les recrutements par une meilleure
promotion des métiers de la vigne et du vin ;
Prendre en compte dans la réflexion les compétences des
établissements spécialisés ; valoriser les efforts qui ont été faits.
La place de la formation professionnelle continue doit
être renforcée pour compléter, renforcer et adapter la qualification des
salariés et des exploitants ;
Maintenir l’offre de formation en bac professionnel ;
Le
BTSA par apprentissage semble susciter un intérêt y compris sur les aspects
commercialisation ;
Face aux nombres important de salariés sans qualification
la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) doit être promue et
développée ;
SECTEUR
TRANSFORMATION DES PRODUITS ISSUS DE L’AGRICULTURE
Groupe de travail du 09 mars 2005
REFLEXION SECTORIELLE TRANSFORMATION
DES PRODUITS ISSUS DE L’AGRICULTURE
PREAB 2005/2009
Plan:
Préambule : la structuration de la filière
Agroalimentaire !
1/ Le positionnement économique du
secteur
2/ Le niveau de qualification des emplois
du secteur
3/ L’emploi et l’organisation du travail
4/ Les emplois et les
principaux métiers du secteur
Préalables & définitions :
La réflexion sur le secteur de
référence, implique de définir les termes suivants :
Le secteur agroalimentaire
recouvre l’ensemble des entreprises dont l’activité consiste à transformer des
produits d’origine agricole ou piscicole en biens alimentaires (Définition INSEE,
reprise du MAP) : exclu les activités artisanales (charcuterie, boulangerie,
pâtisserie artisanale) et la production viticole (la vinification reste
toutefois dans le champ).
La priorité du secteur de la
transformation des produits issus de l’agriculture : cette
terminologie est reprise du 4ème schéma prévisionnel national des formations du
MAP qui définit l’orientation suivante,“L’enseignement agricole doit
afficher une politique ambitieuse pour maintenir et développer, dans le
secteur, une offre de formation attractive et cohérente avec les emplois
disponibles.
Les formations du secteur de
la transformation, et en particulier celui des industries agroalimentaires,
pourtant présentes à tous les niveaux de l’enseignement agricole, voient leurs
effectifs régresser fortement depuis 1998 (- 28%). L’analyse de la situation
actuelle avec l’industrie agroalimentaire doit rapidement donner lieu à un plan
d’actions volontariste et ambitieux, en vue d’améliorer la représentation des
métiers dans le cadre des conventions passées avec les branches
professionnelles.
De plus, une étude concernant
les métiers de la filière transformation animale en lien avec les enjeux de
qualité et de sécurité sanitaire devra être réalisée. Elle devra permettre la
mise en place de nouveaux diplômes, mieux adaptés aux demandes des industries
agroalimentaires.
Concernant les diplômes
existants, il faudra actualiser le BTSA Industries Agroalimentaires (IAA) et
Analyses Agricoles Biologiques et Biotechnologiques (ANABIOTEC). Le BEPA Laboratoire
comme le baccalauréat Bio Industries de Transformation (BIT) devront être rénovés
en liaison avec le ministère chargé de l’Education nationale. Le BTA
Laboratoire devra donc trouver sa place dans le nouveau baccalauréat
technologique et dans le baccalauréat professionnel BIT rénové.
Enfin, le développement des
activités de transformation des produits à la ferme doit être pris en
compte dans les référentiels de formation.”
Une convention nationale de
partenariat MEN, MAP, ANIA: voir la
Convention générale de coopération 2001-2006 entre le Ministère de l’Education
Nationale, le Ministère de l’Agriculture et de la Pèche, l’ANIA et les
organisations syndicales signée le 29 juin 2001.
Un partenariat pour
l’agroalimentaire: le PNDIAA (voir revue BIMA d’octobre 2004 p.4)
Définition :
Etablissement : unité géographique dans laquelle se réalise
l’activité de l’entreprise. (Agreste : graph agri régions 2002, p. 92)
« Le
marché agroalimentaire couvre des secteurs d’activité extrêmement vastes allant
de la ferme au consommateur en passant par des entreprises de transformation,
de transport, d’entreposage et de distribution de toutes tailles…»
L’AGROALIMENTAIRE - L’INNOVATION AU SERVICE DU CONSOMMATEUR
Etude initiée par VisioMeca Rhône-Alpes Réalisée par M.Berchet (Berchet
Conseil)
et DC (E+C) Daniel Coué Etudes et Conseil Novembre 2002
·
Production
·
Transformation
·
Distribution
·
Consommation
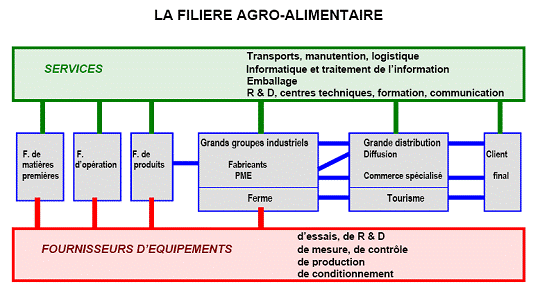
Neufs regroupements professionnels
principaux et, au total, plus de cinquante métiers et spécialités différents.
INDUSTRIE
DES VIANDES : Viandes de boucherie. Viandes de
volailles. Produits à base de viandes.
INDUSTRIE
DU POISSON :
Conservation, congélation surgélation, séchage, fumage, salage... Préparation
de produits (poisson cuit, filets, laitance, caviar,...). Plats préparés.
INDUSTRIE
DES FRUITS ET LEGUMES : Transformation et conservation de pommes de terre. Transformation et
conservation de légumes. Transformation et conservation de fruits. Jus de
fruits et légumes.
INDUSTRIE
DES CORPS GRAS :
Huiles et graisses brutes végétales (tournesol, colza, olive... farines non
déshuilées, tourteaux), et animales (non comestibles). Huiles et graisses
raffinées. Margarines et produits à tartiner.
INDUSTRIE
LAITIERE : Lait
liquides (frais, pasteurisés, UHT...) et produits frais (crèmes, yaourts,
desserts lactés). Beurre. Fromages. « Autres produits laitiers » (laits secs,
laits concentrés, lactose, lactosérum, caséine). Glaces et sorbets.
TRAVAIL
DES GRAINS, FABRICATION DE PRODUITS AMYLACES : Meunerie. Semoulerie. Riz blanchi
ou transformé. Céréales soufflées, grillées, etc. Produits amylacés (amidons,
fécules, sirops de glucose, glutens, tapioca,...)
FABRICATION
D’ALIMENTS POUR ANIMAUX :Aliments pour animaux de ferme. Aliments pour animaux de compagnie.
INDUSTRIE
DES BOISSONS :
Eaux de vie naturelles. Spiritueux. Alcools de fermentation. Champagnisation.
Vinification. Cidrerie. Brasserie. Malterie. Eaux de table (de source ou minérales).
Boissons rafraîchissantes sans alcools (sodas, colas, tonics, sirops de
fruits...)
AUTRES
IAA : Boulangerie
et pâtisserie fraîche. Biscotterie, biscuiterie, pâtisserie de conservation.
Industrie du sucre. Chocolaterie, confiserie. Pâtes alimentaires.
Transformation du thé et du café. Condiments et assaisonnements (vinaigres,
sauces, mayonnaises, moutarde, épices conditionnées, ketchup...). Aliments
adaptés à l’enfant (préparations homogénéisées, laits pour nourrissons...).
Produits diététiques et de régime...
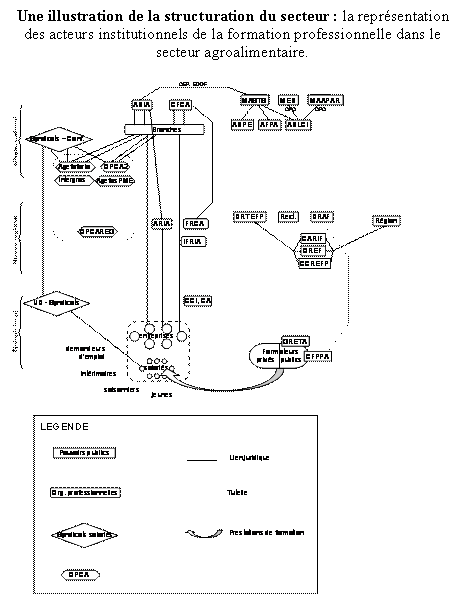
La place des IAA :
·
Premier secteur industriel
français, il emploie 418 000 salariés dans 3100 entreprises
·
5 Régions regroupent la moitié
des emplois (Bretagne et Pays de Loire 25%).
·
25% du chiffre d’affaire est
réalisé par le secteur de l’industrie des viandes. (Agreste, Graph agri régions
2002).
La situation des
petites entreprises (en 2001):
·
3 entreprises sur 4 ont moins de
20 salariés et réalisent 5% du Chiffre d’Affaire des IAA. Elles emploient 9%
des effectifs.
·
25% des effectifs des petites
entreprises sont employés dans l’industrie de la viande, 20% dans l’industrie
des boissons et 9% dans les industries du lait (très présentes en
Franche-Comté). (Bima HS n°16, janvier 2005).
La Coopération Agricole
et les IAA :
·
L’organisation du secteur est
complexe (plus de 50 branches) et a une logique d’organisation verticale selon
la distinction secteur Coopératif (CFCA : Confédération française de la
coopération agricole) et secteur Capitalistique (ANIA : Association Nationale
des Industries Agroalimentaires).
·
La coopération regroupe environ
3700 entreprises 150 000 salariés auxquels s’ajoutent 50 000 saisonniers.
·
ENA – rapport Groupe René Cassin
– 1999, Les exigences de formation liées à la dynamique d’évolution de
l’agroalimentaire
CARTE DES REGIONS (effectifs salariés les IAA 2001-2003)
CEREQ : enquête annuelle 2002
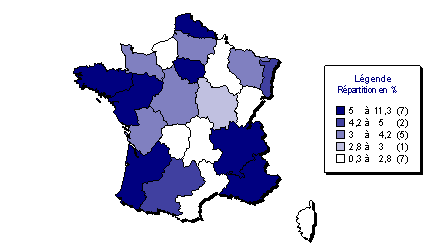
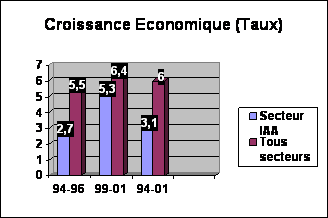
Chiffre d’Affaires des IAA en 2003 : total
124 110 M€
|
I. des Viandes
|
25 %
|
Travail grain, produits amylacés
|
4%
|
|
I. du Poisson
|
2 %
|
Fabrication d’aliments pour
animaux
|
6%
|
|
I. des Fruits & Légumes
|
5 %
|
I. des Boissons
|
15%
|
|
I. Laitière
|
20 %
|
Autres activités
|
23%
|
Bima HS n°16- Janvier 2005, Les chiffres 2005, Les
industries agroalimentaires, pp. 39
?
IDEES-FORCES
·
Un dynamisme important sur les
exportations (supérieur à la moyenne régionale).
·
Plus de 55% des Etablissements
relèvent du secteur des Céréales ou de la Viande, Volaille, Poisson qui
emploient la majorité des effectifs des salariés.
·
Les Etablissements de plus de 50
salariés représentent 37,5%
·
des Etablissements emploient les
trois quarts des salariés.
·
9 998 salariés relèvent de
l’ASSEDIC et 1 796 de la MSA
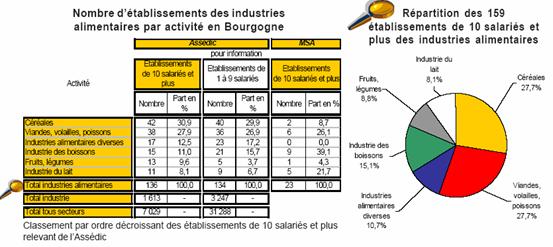
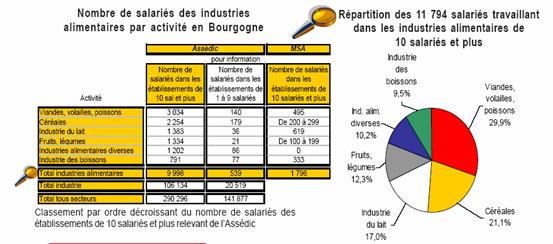
?
IDEES-FORCES
·
La Bourgogne : entre Ile de
France, Rhône-Alpes et Franche-Comté !
·
La Saône-et-Loire est le premier
Département Agroalimentaire de la Région et reste dynamique.
·
La Côte d’Or, second
Département, a perdu de nombreux emplois dans le secteur.
·
L’Yonne concentre de nombreux
emplois (25%).

1989 / 2002 :
Evolution des emplois par Département
·
L’emploi (tous secteurs) en
Bourgogne progresse de 6,1% en 13 ans contre 10,7% au niveau national.
·
L’emploi dans le secteur des IAA
progresse de 4,8% contre 5,2% au niveau national.
Secteur : Industries agricoles et
alimentaires (dont secteur coopératif)
|
Département
|
Salariés
(2002)
|
Evolution 89/02
en pourcentage
|
Evolution 89/02 en nombre
|
|
21 : Côte d’Or
|
4477
|
- 12,3%
|
- 628
|
|
58 : Nièvre
|
1199
|
+ 21,2%
|
+ 210
|
|
71 : Saône-et-Loire
|
6031
|
+ 21,1 %
|
+ 1190
|
|
89 : Yonne
|
3940
|
+ 2%
|
+ 79
|
Source : INSEE « dimensions
Bourgogne » ; l’emploi de 1989 à 2002, résultats statistiques n° 51 à
55
Répartition de l’effectif salarié :
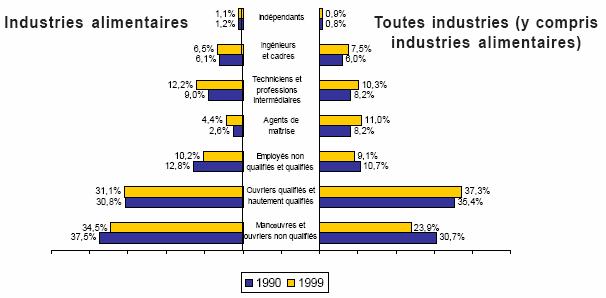
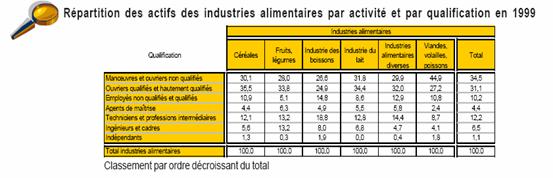
? IDEES-FORCES
·
65,6% des actifs sont des
ouvriers (dont 47,4% qualifiés).
·
L’absence de qualification
demeure plus importante dans ce secteur (34,5% contre 23,9% dans l’industrie)
·
Cohabitent des activités très
automatisées et des domaines d’activités peu industrialisés et manuels (45% de
non qualifiés en Viandes, Volailles, Poissons).
Le vieillissement des actifs :
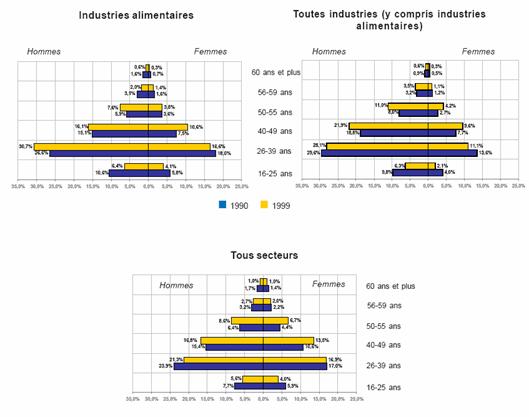
?
IDEES-FORCES
·
Le choc des générations sera
moins fort que dans l’ensemble des secteurs (15,7% de 50 ans et plus contre
20,7% dans l’industrie (recensement de 1999).
·
La part des moins de 26 ans a
baissé de 16,4% à 10,5% entre 1990 et 1999.
La part de l’INTÉRIM dans le secteur :
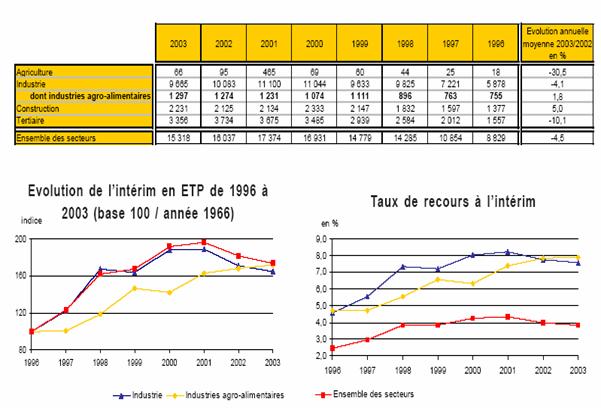
?
IDEES-FORCES
·
Le recours à l’emploi
intérimaire a rattrapé son retard et se maintient alors qu’il baisse dans
l’ensemble des secteurs.
·
La saisonnalité importante des
produits comme des types de consommations contribue à ce phénomène.
Sources : DARES, DRTEFP
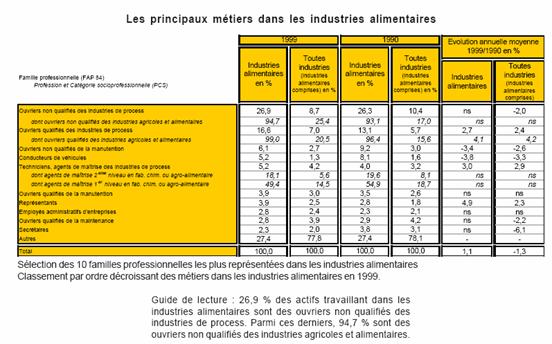

?
IDEES-FORCES
Besoin de main d’œuvre par secteur :
·
42 % des actifs sont des
ouvriers. Parmi ceux-ci 40% sont qualifiés.
·
11,4% des industries agricoles
et alimentaires envisagent de recruter contre 25,2% pour l’ensemble des
secteurs.
·
40% des projets de recrutement
du secteur concerneraient une activité saisonnière et plutôt des ouvriers non
qualifiés.
·
Source ASSEDIC : enquête
BMO 2004
·
Sur 1922 offres d’emploi à
l’ANPE en 2003, 68% concernaient une mission ou un CDD de 1 mois à 6 mois.
·
Sur 387 offres en 2003 à
l’APECITA, 8,8% (34) concernaient le secteur.
|

|
67
Ouvriers non qualifiés de type industriel
|
|

|
674c : Autres ouvriers de
production non qualifiés : industrie agroalimentaire
|
|
Ouvriers
exécutant des tâches simples ou répétitives dans la préparation, la mise en
forme ou le contrôle de produits alimentaires, hors transformation des
viandes, qu’ils travaillent ou non sur machine.
|
|
Professions les plus typiques
|
Professions assimilées
|
Professions exclues
|
|
Agent de ligne (IAA), ouvrier non qualifié
Ouvrier d’usine agricole, ouvrier non qualifié
Ouvrier de brasserie, ouvrier non qualifié
Ouvrier de chai, ouvrier non qualifié
Ouvrier de chocolaterie, ouvrier non qualifié
Surveillant de machines (IAA), ouvrier non qualifié
|
Boulanger (boulangerie industrielle),
ouvrier non qualifié
Conditionneur (IAA), ouvrier non qualifié
Opérateur de mélangeur (IAA), ouvrier non qualifié
Ouvrier de cidrerie, ouvrier non qualifié
Ouvrier de conditionnement (IAA), ouvrier non qualifié
Ouvrier de conserverie, ouvrier non qualifié
Ouvrier de distillerie (IAA), ouvrier non qualifié
Ouvrier minotier, ouvrier non qualifié
Pâtissier (boulangerie industrielle), ouvrier non qualifié
Préparateur de pâtes (IAA), ouvrier non qualifié
|
|
|

|
67
Ouvriers non qualifiés de type industriel
|
|

|
674b : Ouvriers de production
non qualifiés de la transformation des viandes
|
|
Ouvriers
exécutant des tâches simples ou répétitives dans la préparation, la mise en
forme ou le contrôle des produits carnés, qu’ils travaillent ou non sur
machine.
|
|
Professions les plus typiques
|
Professions assimilées
|
Professions exclues
|
|
Désosseur (IAA), ouvrier non qualifié
|
Abatteur (IAA), ouvrier non qualifié
Charcutier (industrie de la viande), ouvrier non qualifié
Equarrisseur (IAA), ouvrier non qualifié
Ouvrier d’abattoir, ouvrier non qualifié
Préparateur de viandes (IAA), ouvrier non qualifié
|
|
|
|
|
|
|
INSEE : nomenclature PCS-ESE 2003 (Professions et
Catégories Socio-Professionnelles des Employés Salariés d’Entreprises)
Les formations existantes :
|
Dispositif / Formation
|
Organisateur
|
Présent en
Bourgogne
|
|
PREQUALIFICATION IAA
|
CRB / MAAPR
|
Oui
|
|
CAPA IAA (3 options)
|
MAAPR
|
Oui
|
|
BEP Bio-Services
|
MEN
|
Oui
|
|
BEPA Transformation
|
MAAPR
|
Oui
|
|
BEPA Services, Ventes de Produits
Frais
|
MAAPR
|
Oui
|
|
BPA IAA
|
MAAPR
|
Non
|
|
Bac Technologique, STPA
|
MAAPR
|
Oui
|
|
Bac Pro B.I.T.
|
MAAPR MEN
|
Oui
|
|
Bac Pro Vendeur Conseil
Spécialisé
|
MAAPR
|
Oui
|
|
BP IAA
|
MAAPR
|
Oui
|
|
BTSA IAA
|
MAAPR
|
Oui
|
|
BTSA ANABIOTEC
|
MAAPR
|
Oui
|
|
BTSA QIABI
|
MEN
|
Oui
|
|
BTSA TECHNICO-COMMERCIAL
P.A.
|
MAAPR
|
Oui
|
|
DUT GENIE BIOLOGIQUE
|
MEN
|
Oui
|
|
CS QUALITE
|
MAAPR
|
Oui
|
|
Formations Ingénieur
ENESAD, ENSBANA
|
MEN MAAPR
|
Oui
|
S’ajoutent l’ensemble des CQP (certificats de qualification
professionnelle).
Evolutions en matières
d’emploi et de formation sectorielles :
Agefaforia
Etude – Mai 2002, Nouveaux facteurs d’évolution, quelle incidences pour les formations
sectorielles ?
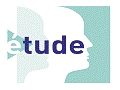
·
Trois orientations :
o Valoriser les Certificats de Qualification
Professionnelle (CQP) dans le cadre de la V.A.E.
o Développer des actions de promotion des métiers, des
systèmes de certification de branche et de diplômes, et des filières de
formation initiale et continue propres à l’industrie alimentaire
o Construire des partenariats avec l’offre de formation
initiale et continue
Autour de quatre
fonctions :



Quelques sources :
Tous nos remerciements au C2R Bourgogne pour nous avoir
permis de reprendre les informations contenues dans son document de travail
« Industries Alimentaires : observation des emplois, des
qualifications et des formations ») à paraître, ainsi qu’au SRSA de la
DRAF Bourgogne.
Publications :
Agefaforia Etude – Mai 2002, Nouveaux facteurs
d’évolution, quelle incidences pour les formations sectorielles ?
Agreste Bourgogne N° 45 - juin 2002, Les industries
agroalimentaires en Bourgogne.
Agreste Bourgogne N° 58 - juin 2004, Les industries
agroalimentaires en Bourgogne en 2002.
Agreste - Enquête annuelle d’entreprise 2002, ANNEE
2002, Etablissements de production agroalimentaires par région
INSEE Première N° 911 – juillet 2003, Les industries
agroalimentaires en 2002
Agreste Primeur N° 146 - juillet 2004, Enquête
annuelle d’entreprise IAA résultats provisoires 2003
BIMA - octobre 2004, Evénement: Un partenariat pour
l’agroalimentaire, p. 4.
BIMA - octobre 2004, Enquête: Le panorama de industries
agroalimentaires, pp. 5, 6.
BIMA – Hors série N° 16 – janvier 2005, Les chiffres de
l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et de la ruralité, édition 2005
ENA – rapport Groupe René Cassin – 1999, Les exigences de
formation liées à la dynamique d’évolution de l’agroalimentaire
Sites Internet :
http://www.agefaforia.com/, http://www.metiers-industries-alimentaires.com
http://www.bourgogne-iaa.com: Le
portail des Industries Agroalimentaires, service proposé par l’ARIA Bourgogne
et l’ARIST / CRCI Bourgogne.
http://www.cereq.fr: Portraits statistiques de branche
(rubrique « Branches »), Secteur Agroalimentaire.
http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/nomenclatures/pcs/pcs.htm:
Professions et Catégories Socioprofessionnelles des Emplois Salariés
d’Entreprise (PCS-ESE 2003)
Participants :
AMIOT Chantal (EPL de Plombières)
BOISSARD Christine (Chambre d’Agriculture - VIVEA)
BONNARDOT Emmanuel (Chambre d’Agriculuture 21)
BOULZAT Christine (OPCA2)
BOULZAT Gérard (EPL de Plombières)
CHAUDRON Patrick (MSA 21 – Prévention)
DELAGNEAU Michel (Chambre d’Agriculture 89)
DORMOY Fleur (APECITA)
GATEAU Francis (EPL de Beaune)
GESUATI Jean-Louis (DRAF – SRFD)
HABERSTRAU Michel (ARIA Bourgogne)
HURE Marcel (Chambre d’Agriculture 89)
LEMOINE Jean-Pierre (DRAF – SRFD)
LISBERNEY Marie-Jacqueline (EPL Mâcon-Davayé)
MONTENOT Claude (EPL de Plombières)
MORIZOT-BRAUD Françoise (CERD – Chambre Agriculture 58)
PERDREAU Jean-Paul (DRAF – SRFD)
PETERMANN Patrice (Inspection de l’Enseignement Agricole)
ROUMIER Chantal (DRAF – SRSA)
ROUSSEL Roger (EPL Auxerre)
Excusés :
ADNET Natalie (Chambre d’Agriculture de l’Yonne)
BARTHEL Denis (FAFSEA)
JAMET Thierry (AGEFAFORIA)
NAIGEON Valérie (C2R)
PETITJEAN Stéphanie (EPL Plombières)
SANCHEZ Denis (Chambre d’Agriculture 58)
Rappel des principaux points abordés :
·
le contexte du PREAB :
cadre institutionnel et réglementaire ; calendrier de travail jusqu’en
juillet 2005 (document remis )
·
présentation d’éléments
d’information sur le secteur des travaux paysagers (document présenté et
remis) :
o contexte régional ;
o positionnement économique du secteur de la
transformation des produits agricoles;
o le niveau de qualification des emplois dans le
domaine de la transformation des produits agricoles ;
o l’emploi et l’organisation du travail dans le
domaine;
o les emplois et les principaux métiers dans le
secteur de TP
·
présentation de l’offre de
formation et de son évolution entre 2001 et 2005 dans le secteur des travaux
paysagers.
Objectif de cette réunion :
Débattre et échanger sur la
problématique « emploi-formation-qualification-compétences » dans le
secteur de la transformation des produits agricoles en vue d’éclairer le groupe
de travail et le comité de pilotage du PREAB sur les principaux constats à
effectuer et sur les principales orientations à prendre par l’enseignement
agricole de Bourgogne, dans ce secteur, entre 2005 et 2009, en termes :
·
de promotion des métiers
·
de niveaux de formation et de
qualification,
·
de nombre de formés,
·
d’évolution complémentaires des
voies de formation ( initiale scolaire ; initiale apprentissage ;
formation professionnelle continue)
·
de répartition territoriale de
l’offre de formation sous ses différents aspects
Le contexte régional est rappelé :
. Une population stable,
qui vieillit, peu qualifiée, comptant plus d’inactifs que d’actifs et qui perd
des lycéens et des étudiants. »
Source : Schéma Prévisionnel des
Formations 2005 – 2006 – 2007, Conseil Régional de Bourgogne, 12/2004, p.3.
Le
contexte national du secteur est rappelé :
·
Le 4ième Schéma
Prévisionnel National des formations du MAAPR -> secteur prioritaire pour 2005-2009
·
Une Convention Générale de
Coopération avec l’ANIA pour 2001-2006
·
Un Partenariat National de
Développement des IAA (dès 2004) (PNDIAA)
La
définition du secteur de la transformation des produits agricoles reste
peu praticable pour désigner l’ensemble des acteurs:
·
A l’amont du secteur on retrouve
« l’agroalimentaire paysan »
·
Pour l’ARIA, la question est
tranché: il y a Industrie Agroalimentaire si il y a transformation (l’activité
de stockage étant comprise comme activité de transformation), et si
l’importance du circuit de distribution est significative
·
Pour l’INSEE et le MAAPR : Transformation
des produits agricoles et piscicoles (dont vinification mais pas la production
viticole) en biens alimentaires
Constats repris et/ou développés lors de la réunion:
-
Le secteur est le premier
secteur industriel français et est prioritaire pour les acteurs institutionnels
(MAAPR ; Conseil Régional, acteurs professionnels)
-
Les chiffres doivent être
utilisés avec précaution (évolution des effectifs d’un département peuvent
reposer sur la politique d’un seul Etablissement)
-
Il y a des préoccupations
communes entre les activités de transformation agricoles et les IAA :
qualité et sécurité notamment
-
Le secteur est réparti entre
l’univers coopératif et l’univers industriel
-
Il y a un représentativité
départementale inégale du secteur (Saône-et-Loire : 1ier département
en effectifs en nombre d’Etablissement)
-
Le maintien du tissu de TPE et
PME de petites tailles sur la Région est un enjeu important
-
Il y a un besoin important
d’opérateurs notamment dans le secteur de la viande
-
Les établissement se réduisent
de plus en plus à la structure de production sans départements R&D,
commercial et administratif intégrés : ce mouvement concentre les besoins
d’emploi et de qualification sur la production (sans mobilité)
-
Il y a des besoins de formation
notamment pour accompagner les activités de diversification mais qui relèvent
de la formation permanente et pas de la formation initiale
-
L’orientation vers la
transformation peu faire suite un premier projet sur la production agricole et
relève dans ce cas de la spécialisation, et donc de la formation continue
-
Des dispositifs de formation
adaptés du silo aux IAA existent au MAAPR: formations UC (CAPA, BPA, BP en
IAA)
-
Le secteur n’est pas attractif
pour les jeunes
-
le développement des activités
de transformation à la ferme est important et doit être soutenu (4ème
schéma)
Propositions en termes d’orientations à prendre :
-
La promotion des métiers du
secteur est essentielle (plan d’action de l’ARIA annoncé)
-
L’image même des métiers demande
à évoluer notamment par les pratiques des entreprises en matière d’accueil et
de tutorat, de valorisation des métiers.
-
Les entreprises autant que les
acteurs externes (formation notamment) doivent se mobiliser
-
La formation des tuteurs doit se
renforcer
-
Favoriser l’orientation des
jeunes sur leur zone d’origine afin de favoriser l’insertion
Constats repris et/ou développés lors de la réunion:
-
La majorité des emplois du
secteur concernent des ouvriers non qualifiés ou des ouvriers qualifiés de
niveau V :
o Les premiers correspondent à des métiers encore
fortement manuels et en contact avec le produit
o Les seconds concernent des métiers très automatisés
-
50% des salariés sont des
entreprises de 50 salariés et plus : concentration des emplois
-
Il y a un besoin de formation
des chauffeurs (dans le transport des produits alimentaires)
-
Il y a un décalage entre les
besoins du secteur et les attentes des jeunes
-
Il faut éviter les
spécialisation trop précoce dans ce secteur (maturité pour le choix du secteur)
-
Le niveau IV est le niveau
requis pour une embauche qualifiée dans le secteur. Pour le reste, l’embauche
se réalise majoritairement sans qualification
-
Une partie de politique de
recrutement est souvent confiée aux intervenants en formation
Propositions en termes d’orientations à prendre :
-
Nombre de problématiques
d’emplois et de qualifications peuvent être examinées de manière transversale
entre production et transformation
-
Il y a nécessité de véhiculer une
représentation moderne de ces métiers (Bac Pro BIT fonctionne mieux en cosmétologie
et en pharmacologie !)
Constats repris et/ou développés lors de la réunion:
-
les besoins concernent
essentiellement les opérateurs (ouvriers qualifiés et ouvriers non qualifiés)
et l’encadrement intermédiaire qui est peu représenté
-
Les emplois intérimaires sont
plus présents que la moyenne du secteur industrielle dans le secteur des IAA et
sont prescripteurs de formation
-
peu d’emploi sur les niveaux I
-
Propositions en termes d’orientations à prendre :
-
Jusqu’au niveau IV, proposer des
formations avec socles commun pour la production comme la transformation, et
spécialiser à partir du niveau IV : idée d’une plateforme d’orientation.
-
Mise en place d’un BTSA IAA par
apprentissage en 2005 et d’une Licence Pro en 2006
Constats repris et/ou développés lors de la réunion:
|
Département
|
Type de formation
|
CAPA
|
BEPA
|
BAC PROF
|
BTSA
|
|
21
|
FIS
public
|
|
60
|
33
|
57
|
|
FIS
privé
|
|
|
|
|
|
App
public
|
|
|
12
|
69
|
|
App prive
|
4 (IFRIA)
|
|
11
|
|
|
FPC
public
|
|
|
|
|
|
FPC privé
|
|
|
|
9100
|
|
Département
|
Type de formation
|
CAPA
|
BEPA
|
BAC PROF
|
BTSA
|
|
71
|
FIS privé
|
|
41
|
|
|
|
Département
|
Type de formation
|
CAPA
|
BEPA
|
BAC PROF
|
BTSA
|
|
89
|
FIS public
|
|
31
|
18
|
58
|
|
FIS privé
|
|
14
|
|
|
-
il y a un problème sur le niveau
V
-
il n’y a pas de niveau IV
spécifique à la transformation (IAA), mais le B.I.T. en apprentissage semble
correspondre aux entreprise
-
les Régions limitrophes (Rhône-Alpes,
Iles de France, Franche Comté et Alsace) captent des jeunes
-
effectif concentré sur le
BTS : attention à la baisse démographique et à l’adéquation avec les
besoins en matière d’emploi
Propositions en termes d’orientations à prendre :
-
un niveau V et un niveau IV par
Département
-
la base des orientations est le
contrat d’objectif, qui doit être lui en adéquation avec les accords de branche
-
il y a nécessité à structurer la
filière de formation et à la rendre lisible (collège au niveau I)
-
l’ARIA demande la création d’un
groupe de travail spécifique sur le question du niveau V (plateforme
production/transformation). L’ARIA affirme sa volonté de mettre des moyens sur
ce dossier si nécessaire.
-
L’IFRIA se donne l’objectif de
70 apprentis dont 50 dans un premier terme
SECTEUR
AMENAGEMENT
Groupe de travail du 22 mars 2005
PREAB 2005/2009
PLAN
1/ Le positionnement
économique du secteur
2/ Le niveau de
qualification des emplois du secteur
3/
L’emploi et l’organisation du travail
4/ Les emplois et les
principaux métiers du secteur
?IDEES-FORCES//
·
La Bourgogne est une région très boisée :
o
30.5% du territoire,
o
moyenne nationale : 25%,
o
la forêt couvre 970 000 ha (cinquième région française).
·
Les forêts privées sont nombreuses, elles représentent en surface
les 2/3 de la forêt bourguignonne et appartiennent à environ 166 000
propriétaires. Il y a de plus des forêts publiques renommées.
·
La Bourgogne :
o
est la première région de France en surface et production de
chênes (la forêt bourguignonne est largement dominée par les peuplements feuillus);
o
les conifères principalement issus de plantations, ne représentent
globalement que 17% de la superficie boisée;
o
bien que toujours minoritaires dans l’ensemble des régions
forestières, la proportion des conifères est en augmentation et atteint 40%
dans le Morvan et le Clunisois, ce qui provoque parfois des impacts paysagers
conflictuels.
·
La forêt bourguignonne a
une forte vocation productive, mais aussi récréative (accueil du public),
paysagère et cynégétique.
·
La filière bois
o
L’ensemble de l’activité de la filière-bois en Bourgogne
contribue au maintien de l’emploi en zone rurale,
o
et représente plus de 2600 entreprises pour un total de près de
20 000 emplois.
o
La valorisation du potentiel forestier et les activités de
transformation du bois fournissent beaucoup d’emplois dans le Châtillonnais, le
Morvan, la Bresse, la Puisaye.
o
La récolte et la transformation des bois génèrent 5% de la valeur
ajoutée totale produite en Bourgogne.
·
Le secteur de la production
o
est contraint aux règles d’un marché peu structuré et de
plus en plus concurrentiel.
o
Plus de 90% des exploitations forestières se sont créées au cours
des vingt dernières années.
·
Le secteur de l’exploitation forestière a connu
o
deux vagues de mécanisation en 1986 et 1993;
o
cela a comme conséquence une hausse des coûts fixes.
·
La tempête de 1999
o
Elle a eu comme effet de saturer le marché et l’affaiblissement
des prix. : la surproduction signifie stockage et donc capital immobilisé.
o
Du coup, des hommes qui auparavant étaient spécialisés sur un
seul type d’activité ont dû se diversifier de façon à pouvoir effectuer plusieurs
tâches (exemple : le débardage avec le bûcheronnage); la tempête a conduit
à exiger des compétences et de la polyvalence supplémentaires pour augmenter la
productivité.
·
Face à l’avenir, les ETF peuvent être classées en trois catégories :
o
entreprises en grande difficulté :cessation d’activité,
forte pression psychologique pour les employeurs et les salariés,
o
entreprises en diversification dans le maintien de l’activité,
o
entreprises en diversification depuis longtemps, recherche
d’optimisation de la productivité.
·
On constate une diminution du nombre des exploitations et donc
une augmentation de la taille des entreprises.
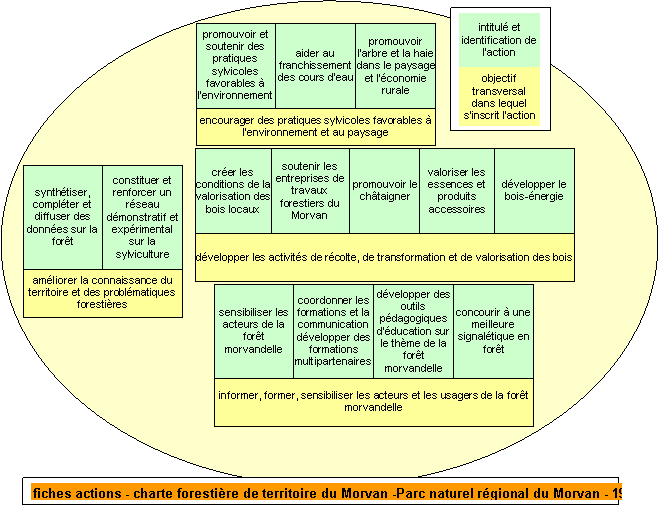
·
Le « contrat de Progrès Filière Bois»
a été signé en juin 2005, par les représentants de l’Etat, le Conseil Régional
et l’Association pour la Promotion et la Valorisation des activités du bois en
Bourgogne, APROVALBOIS. Il définit les orientations à privilégier pour le
développement de la filière forêt-bois en Bourgogne, pour les années 2005 à
2007.
o
Engagés dans une démarche fondée sur le développement durable de
la forêt et de la filière bois au sein des territoires ruraux, les différents
acteurs de la forêt se sont fixés 4 axes de progrès :
§
axe de progrès n°1 : la valorisation de la ressource,
§
axe de progrès n° 2 : l’amélioration de la compétitivité des
entreprises,
§
axe de progrès n° 3 : le développement de nouveaux marchés,
§
axe de progrès n° 4 : l’animation de la filière et du
contrat de progrès.
o
Le deuxième axe de progrès inclut une action dont le but est de
« soutenir la formation et le recrutement de personnels
spécialisés ». « Les difficultés de recrutement et de fidélisation de
la main-d’œuvre dans tous les secteurs de la filière bois, hors celui de la
gestion forestière, sont un frein au développement des entreprises. Pour
remédier à ce handicap, il est proposé de conduire des actions de
sensibilisation et d’information des jeunes, de valoriser les moyens de
formation existants et de faciliter le recrutement de personnels spécialisés. ».
?IDEES-FORCES
·
Les jeunes en formation sont souvent hors cadre familial,
o
donc n’ont aucune connaissance de l’environnement professionnel;
o
c’est pourquoi la majorité d’entre eux poursuit un cursus d’étude
vers des BTS et se destine à des emplois hors de la production et de
l’exploitation forestière voire hors de la filière.
·
Les diplômes de l’enseignement agricole secteur de la production
forestière
o
niveau V :
§
CAPA travaux forestiers,
§
CAPA ouvrier d’exploitation forestière
§
CAPA ouvrier sylviculteur
§
CAPA conducteur de machines d’exploitation forestière
§
certificat de spécialisation élagage
§
BEPA travaux forestiers
§
BPA production forestière :abattage, façonnage
§
BPA par UC conduite et entretien des engins de l’exploitation
forestière
§
BPA chef d’entreprise ou ouvrier hautement qualifié en travaux
forestiers de débardage ou en travaux forestiers de sylviculture
·
Les salariés des exploitations
o
ont souvent peu de formation initiale ou un niveau V (BPA),
o
et peu suivent des actions de formation continue hormis les
actions sécurité de la MSA.
·
Les diplômes de l’enseignement agricole secteur de la production
forestière
o
niveau IV :
§
BAC PRO gestion et conduite des chantiers forestiers
§
BP par UC travaux forestiers
o
niveau III
§
BTSA gestion forestière
§
BTSA technico-commercial « produits d’origine forestière
?IDEES-FORCES
Les salariés ont les caractéristiques suivantes :
·
une moyenne d’âge supérieure ou égale à 40 ans,
·
une ancienneté de 5 à 15 ans et plus.
Exemple d’une exploitation forestière
occupant plus de dix salariés
les fonctions sont réparties comme suit :
·
l’exploitant gère les achats, la vente la répartition de
l’activité,
·
le personnel administratif principalement les épouses qui
travaillent souvent sans statut et ne sont pas rémunérées,
·
le chef d’exploitation fait le lien entre l’exploitant et le
commis,
·
le commis de coupe et/ou commercial repérage du chantier,
estimation des volumes, gestion des équipes intervenantes et du parc matériel,
·
les bûcherons, les débardeurs et les conducteurs de machines
exécutent les travaux sur les consignes des commis,
·
les chauffeurs transportent le bois du lieu de dépôt aux wagons
ferroviaires ou directement chez le client.
?IDEES-FORCES
·
Dans les exploitations, le recrutement est rural et local, le
tissu relationnel, les critères retenus pour l’embauche
ne sont pas toujours liés à la formation ou à l’expérience professionnelle,
mais à la motivation des candidats et à la proximité géographique.
·
Dans certaines zones rurales, nous trouvons de la main-d’œuvre
d’origine turque de la première génération qui
est en fin de carrière et les entreprises vont devoir envisager leur
renouvellement.
·
les métiers de la production
o bûcheron :
abat les arbres sans faire de dégâts aux peuplements, en facilitant le travail
du débardeur, à les façonner, à classer les différentes catégories de produits
en fonction de leur utilisation,
o conducteur
d’engins forestiers : il conduit et entretient des engins
d’exploitation forestière (engins de sylviculture mécanisée, d’abattage façonnage…),
o débardeur :
transporte les bois coupés par le bûcheron jusqu’à une place de dépôt située au
bord d’une route forestière où le camion pourra venir les charger,
o élagueur :réalise
des tâches de taille, de démontage, d’abattage en assurant le respect du
végétal, il apport des soins et conseils,
o entrepreneur
de travaux forestiers : il réalise des travaux de reboisement,
d’entretien de la forêt, abattage, débardage et élagage pour les scieries,
propriétaires privés, coopératives…
·
les métiers de la production
o bûcheron :
abat les arbres sans faire de dégâts aux peuplements, en facilitant le travail
du débardeur, à les façonner, à classer les différentes catégories de produits
en fonction de leur utilisation,
o conducteur
d’engins forestiers : il conduit et entretient des engins
d’exploitation forestière (engins de sylviculture mécanisée, d’abattage façonnage…),
o débardeur :
transporte les bois coupés par le bûcheron jusqu’à une place de dépôt située au
bord d’une route forestière où le camion pourra venir les charger,
o élagueur :réalise
des tâches de taille, de démontage, d’abattage en assurant le respect du
végétal, il apport des soins et conseils,
o entrepreneur
de travaux forestiers : il réalise des travaux de reboisement,
d’entretien de la forêt, abattage, débardage et élagage pour les scieries,
propriétaires privés, coopératives…
·
La production regroupe deux grandes familles de métiers qui se méconnaissent :
o exploitants
forestiers et ETF de bûcheronnage et abattage ceux qui récoltent
o ceux
qui cultivent : pépiniéristes de reboisement et ETF sylvicoles.
·
les métiers de la production
o entrepreneur
de travaux sylvicoles : professionnel de la gestion durable des forêts,
réalise tous les travaux nécessaires à la création, l’entretien, l’éducation et
l’amélioration des peuplements forestiers,
o exploitant
forestier : c’est un commerçant, il achète du bois aux propriétaires
forestiers publics ou privés et le revend aux usines de transformation,
o ouvrier
forestier : met en œuvre les techniques rationnelles d’abattage adaptées
aux peuplements forestiers dont il doit réaliser l’abattage L’ouvrier forestier
réalise les mêmes travaux qu’un entrepreneur de travaux forestiers, toutefois
contrairement à ce dernier, si son activité principale est l’abattage des
arbres, il peut se voir confier d’autres travaux comme l’élagage, les
plantations, les dégagements de semis, le débroussaillement…,
o sylviculteur :
réalise tous les travaux nécessaires à la création, l’entretien, l’éducation et
l’amélioration des peuplements forestiers.
·
les métiers de la première transformation :
o affûteur
en scierie : assure l’entretien des outils de coupe utilisés sur les machines
de scierie,
o chef
de parc ou contremaître de scierie : son activité a un caractère commercial,
il dirige la production et les relations avec la clientèle, il assure un suivi
des rendements et des prix de revient,
o commis
de coupe : est chargé d’approvisionner en matière première les unités
de première transformation (estimation de lots de bois, classement et valorisation
des lots, organisation des chantiers d’exploitation forestière),
o conducteur
de machine à bois : il assure la conduite des machines servant à la
transformation du bois : scierie, menuiserie, charpente…,
o scieur :
il débite les troncs d’arbres (grumes) en bois d’œuvre pour la charpente, la
menuiserie, l’ameublement.
o conducteur
de grumier, livreur, cariste
·
les métiers de seconde transformation :
o agenceur :
il participe aux travaux d’aménagement ou de décoration , à partir de projets
conçus par les architectes d’intérieur, il réalise des documents techniques et
assure la coordination entre les différents corps de métier,
o charpentier,
o ébéniste :
il fabrique et restaure des meubles,
o marqueteur,
o menuisier :
il fabrique en atelier les éléments d’agencement…
·
On retrouve des métiers liés aux fonctions commerciales tant dans
les secteurs de la production que de la transformation.
Participants
ABORD DE CHATILLON Renaud (PDT UR Synd. Sylviculteurs de Bourgogne PDT
ABCF)
AUGOYAND Sylvain (ETF)
BLONDELLE Martial (PDT CIPREF –ETF mécanisé)
BROCHOT Jean-Marc (DRAF SRFD)
BUTEAU Danièle (CFPPA Morvan)
BUTTIGHOFFER André (ONF Nièvre)
CAVET DUPAS Danielle (Lycée forestier de Bourgogne)
CHAMBON Roland (DRAF SRFD)
CHRETIEN Michel (Expl. For. CIPREF)
CUCHET Emmanuel (AFOCEL)
DROUOT Jean-Pierre (DRAF SRFD)
FOSSURIER Raymond (ONF Saône-et-Loire)
GAITEY Jean-François (UEBB)
GESUATI Jean-Louis (DRAF SRFD)
GILOT Bernard (EPLEFPA Velet)
GOGLINS Hubert (EPLEFPA Morvan)
GUYOT Marie-Paule (FAFSEA)
JACQUEMARD Robert (PDT CA Velet)
KIELBASA Daniel (CFPPA forestier)
LAVILLONNIERE Jean-François (Lycée forestier de Bourgogne)
LEMOINE Jean-Pierre (DRAF SRFD)
MERIAUX Jean-Michel (DRAF SERFOB)
MONNIER Pierre (CFA Saône-et-Loire)
PATEY Delphine (DRAF SRFD)
PAUQUAI Francis (CRPF Bourgogne)
PERDREAU Jean-Paul (DRAF SRFD)
REGNER Bruno (Pépinières NAUDET)
ROBERT Daniel (DRAF SERFOB)
ROBIN Jean-Dominique (DDAF Saône-et-Loire)
TURE Cédric (Animateur CIPREF)
Les principaux points abordés :
- le contexte du PREAB :
cadre institutionnel et réglementaire ; calendrier de travail
jusqu’en juillet 2005 (document remis )
- présentation d’éléments
d’information sur le secteur « forêt et métiers du bois » :
- contexte régional ;
- positionnement économique du
secteur « forêt et métiers du bois »;
- le niveau de qualification des
emplois dans le domaine « forêt et métiers du bois »;
- l’emploi et l’organisation du
travail dans le domaine « forêt et métier du bois »;
- les emplois et les principaux
métiers dans le secteur « forêt et bois »
- présentation de l’offre de
formation et de son évolution entre 2001 et 2005 dans le secteur
« forêt et métiers du bois ».
Objectif de cette réunion :
Débattre et échanger sur la
problématique « emploi-formation-qualification-compétences » dans le
secteur « forêt et métiers du bois » en vue d’éclairer le groupe de
travail et le comité de pilotage du PREAB sur les principaux constats à
effectuer et sur les principales orientations à prendre par l’enseignement
agricole de Bourgogne, dans ce secteur, entre 2005 et 2009, en termes :
·
de promotion des métiers du
bois
·
de niveaux de formation et de
qualification,
·
de nombre de formés,
·
d’évolution complémentaires des
voies de formation ( initiale scolaire ; initiale apprentissage ;
formation professionnelle continue)
·
de répartition territoriale de
l’offre de formation sous ses différents aspects
Positionnement économique du secteur bois production
et transformation (éléments complémentaires aux
documents remis en séance)
ü Le secteur de la production est peu structuré
contrairement à celui de la transformation.
ü La profession est prudente quant à l’installation
d’une unité de première transformation dans le Morvan, mais pourquoi pas une
unité de deuxième transformation ?
ü Il faudrait encourager la replantation dans le
Morvan pour assurer la pérennité.
ü Le Conseil Général de Saône-et-Loire mène une réflexion
sur la filière Bois.
Constats repris et/ou développés lors de la réunion:
- deux scenarii pour le
Morvan :
- soit la profession continue à
exporter la richesse « bois » en Italie ou Belgique,
- soit la profession s’organise
pour mieux valoriser le bois et créer de l’emploi sur place (c’est le cas
à Sougy/Loire).
- Les profils des employés
embauchés sont plus le résultat d’une culture rurale (basée sur des
acquis sociaux et culturels ruraux) que celui d’une culture
professionnelle : les exploitations aujourd’hui embauchent plutôt des
jeunes du milieu rural, mais pas forcément formés…Mais il y a de moins en
moins de ressources humaines dans le milieu rural.
- Les pépinières forestières
embauchent du personnel qualifié de niveau V.
- Il devient de plus en plus
difficile de trouver des bûcherons pour l’exploitation des taillis, et la
mécanisation des taillis est loin d’être encore au point.
- L’ONF recrute très peu
actuellement, car la structure connaît une restructuration étalée dans le
temps et une spécialisation.
- Les scieries exigent des gens
qualifiés. La polyvalence reste une réalité, mais l’augmentation des
unités entraîne plus de spécialisation.
- L’emploi dans la forêt
privée : 160 000 sylviculteurs qui sont des micro-entreprises et
d’ici 2015 perspective de 1500 emplois directs et gisement de 10 000
emplois potentiels si on fait la promotion des métiers de l’abattage.
- Le Président de l’Union
Régionale des Sylviculteurs de Bourgogne et ABCF (association
bourguignonne de certification forestière) émet l’hypothèse qu’avec les
160 000 sylviculteurs s’annonce la perspective d’ici 2015 de 1500 emplois
directs et un gisement de 10 000 emplois potentiels si on fait la
promotion des métiers d’abattage Il regrette par ailleurs, que le Projet
d’Action Stratégique de l’Etat en Région ne fixe pas comme prioritaire la
création d’un pôle de compétitivité bois. La situation est complexe au
niveau de l’interprofession.
Propositions en termes d’orientations à prendre :
- Pour les travaux de
bûcheronnage, façonnage, débardage, embaucher des ruraux, qui connaissent
mieux le secteur et les former ensuite par la formation adulte.
- Le bûcheronnage est de plus en
plus mécanisé, il y a donc nécessité à former des « conducteurs
d’engin » capables entre autre de maîtriser l’informatique embarquée.
- Il faut encourager à planter
pour assurer la pérennité de la production.
Constats repris et/ou développés lors de la réunion:
- Les simulateurs de Velet
semblent déjà dépassés et nécessiteraient des aménagements.
- Le bac professionnel est jugé
favorablement par la profession qui pense que les jeunes qui le possèdent
ont un niveau général supérieur.
- Les pépinières forestières
embauchent du personnel qualifié de niveau V.
- Pas de formation courte en
pépinière forestière au CFPPA de Velet.
Propositions en terme d’orientations à prendre :
- Le bûcheronnage est de plus en
plus mécanisé, il y a donc nécessité de former des « conducteurs
d’engin ».
- La formation de base d’un
conducteur d’abatteuse doit être : sylviculture, mécanique,
hydraulique, électricité, classement des bois.
- La formation doit amener les
jeunes à être capables de travailler sur deux postes.
- Etablir des conventions
« établissement / professionnels » pour mieux former les élèves
aux matériels et technologies nouvelles et ainsi éviter de travailler dans
les établissements sur des matériels dépassés.
- Ne pas se lancer dans une
approche de type « scierie pédagogique ».
- Etablir des liens de
coopération internationale avec la Suède et la Finlande.
- Affiner l’analyse des besoins
de formation dans le secteur de la pépinière forestière.
- Mettre en place des formations
courtes en pépinière forestière au CFPPA de Velet.
- Prendre systématiquement en
compte les exigences réglementaires de sécurité dans les formations.
Constats repris et/ou développés lors de la réunion:
- Il existe en France
actuellement 8 centres de formation et 550 abatteuses, en Finlande, il
existe 1700 machines pour également 8 centres. A l’horizon 2010 il y aura
en France 750 machines (étude AFOCEL). Faut-il que chaque région forme ses
conducteurs d‘abatteuse?
- Malgré la dangerosité des
métiers de la forêt et du contexte du « tout sécuritaire », la
profession est favorable à l’apprentissage au niveau IV.
Propositions en terme d’orientations à prendre :
- Il faut d’ici 2010 former 50
à100 conducteurs d’abatteuse par an en France soit 5 à 10 par an en
Bourgogne (source AFOCEL).
- Envisager plus de formation
professionnelle continue pour accompagner les salariés dans les métiers de
la filière.
- L’encadrement juridique et
réglementaire de la formation dans le cadre de l’apprentissage seraient à
améliorer pour développer cette voie de formation.
« EXPLOITATION FORESTIERE :
Ce secteur très fragile, du fait de prix de prestations
insuffisants ,notamment pour la mobilisation du bois d’industrie, s’est très
fortement mécanisé avec des machines extrêmement performantes, mais également
très onéreuses (380.000 € pour une abatteuse, 240.000 € pour un porteur).
L’exploitation des résineux est très mécanisée en
Bourgogne (75%), alors que la moyenne en France est de 45%.
Du fait de l’augmentation des volumes résineux à récolter
(triplement en 20ans), il y aura nécessairement besoin de conducteurs
supplémentaires d’abatteuses et de porteurs, bien formés et d’un bon niveau, du
fait de la performance et de la technologie des machines.
Il serait souhaitable de réserver une place aux bûcherons
manuels dans les gros bois, mais cela constitue probablement un vœu pieu, car
du fait du travail en flux tendu, cela n’est concevable que si ces bûcherons
travaillent en équipe, afin de pouvoir alimenter au moins un porteur.
Dans les feuillus, dont la récolte est à peu près stable,
l’abattage-façonnage de gros bois de qualité nécessitera toujours des bûcherons
manuels.
En revanche, il devient de plus en plus difficile de
trouver des bûcherons pour l’exploitation des taillis. Et la mécanisation pour
les taillis est loin d’être encore au point.
« PREMIERE TRANSFORMATION »(Sciagedéroulage) :
Le nombre de scieries est en diminution régulière :
d’ici 5 à 10 ans, il ne restera vraisemblablement plus que 70 scieries (au lieu
de 120), dont 50 seront dans le circuit économique général.
A l’exception des scieries mobiles, la création de nouvelles
unités de sciage est exceptionnelle, car très capitalistique et difficile à
rentabiliser sur du court ou moyen terme.
Toutefois, en feuillus, malgré la diminution du nombre de
scieries, la production de sciages devrait rester stable. Les effectifs devraient
rester à peu près constants, car l’augmentation de productivité inéluctable
pour rester compétitifs, sera accompagnée simultanément d’investissements
permettant d’améliorer la valeur ajoutée (séchage, rabotage, …).
Le sciage des résineux est beaucoup plus simple et rapide,
et nécessite moins de main d’œuvre. Les unités sont beaucoup plus productives.
Si le sciage des résineux (Douglas et Epicéa) est réalisé
sur place ou à proximité immédiate, du fait des volumes attendus dans les 20
ans à venir (triplement de la récolte), il y aura besoin de personnel
supplémentaire.
Mais actuellement, les scieries ont du mal, dans les campagnes
reculées, à trouver de la main d’œuvre qualifiée et motivée, ne serait-ce que
pour renouveler leur personnel (départs à la retraite).
Il y a donc un véritable enjeu, pour les scieries à
trouver des personnels capables de se spécialiser et de s’adapter à des
machines de plus en plus performantes, et qui acceptent de vivre en zone
rurale.
PREAB 2005/2009
PLAN
1/ Le positionnement
économique du secteur
2/ L’emploi et
l’organisation du travail dans le secteur
3/ Le niveau de
qualification des emplois du secteur
4/
Les emplois et les principaux métiers du secteur
Quelques précisions :La
réflexion sur le secteur de référence, implique de préciser:
Les activités du
Paysage : tout ce qui touche à
l’environnement utilitaire et de loisir. Les prestations réalisées par les
Professionnels des jardins et espaces verts sont nombreuses à savoir : la
création de parcs, de jardins, de terrasses, la création d’espaces verts
nouveaux, mais aussi la réhabilitation d’espaces anciens ; entretien et
maintenance ; reboisement et plantations forestières ;aménagement de
plan d’eau ou bassin, de cours d’eau , de berges ; aménagement de talus et
aires de repos d’autoroute ; terrain de sport ; petites
voiries ; élagage et débroussaillage ;arrosage intégré…
La profession de paysagiste demeure une activité
de service, il s’agit d’une prestation conduisant à offrir à un
client un service en fonction d’une commande déterminée en utilisant des moyens
matériels et
en vendant des « heures de main-d’œuvre ».
?IDEES-FORCES
·
Le secteur est florissant, beaucoup d’entreprises ont été créées.
·
Les activités sont diversifiées : ainsi, le chiffre
d’affaire se répartit de la façon suivante :
o
création de jardins et d’espaces verts : 49%
o
l’entretien des espaces verts : 34%
o
l’élagage : 7%
o
le paysage d’intérieur, le fauchage, l’aménagement de terrain de
sport, la création des espaces autoroutiers, le reboisement, le
débroussaillement et la végétalisation par projection. …. 10%
·
Les petites structures composent l’essentiel de la profession :
o
60% sont des entreprises entre 0 et 6 salariés,
o
33% sont des entreprises entre 6 et 14 salariés,
o
7%sont des entreprises de plus de 14 salariés.
·
Le secteur doit sans arrêt s’adapter aux nouvelles donnes. Cela
nécessite une remise en cause constante sachant que la faible taille des
entreprises, le raisonnement de producteur, le centrage sur l’activité de
chantier… ne prédisposent pas toujours les paysagistes à anticiper le
changement, ni à faire de la prospective.
·
La concurrence accrue, les exigences de la clientèle vont de pair
avec des prestations de qualité qui impactent tous les emplois (certification
des entreprises).
·
Le développement de matériel plus performant : mini pelle,
tondeuse auto-portée… nécessite pour les utilisateurs des savoir-faire de plus
en plus pointus.
·
Les conditions réglementaires en matière de sécurité au travail,
de gestion des déchets et d’utilisation de produits phytosanitaires rendent les
emplois de plus en plus qualifiés.
·
Initialement centré sur la réalisation de chantiers (production),
le développement de la relation avec le client demeure un enjeu fort pour les
entreprises du paysage. Il demande aux salariés de ce secteur de développer des
aptitudes relationnelles.
·
Un responsable sur quatre connaît la date de transmission de son
entreprise et le nom du futur repreneur.
·
Les clients des entreprises du paysage sont
o
les particuliers (39%),
o
les entreprises (20%),
o
la commande publique (37%).
·
Le jardin n’étant pas un produit de première nécessité, il est
largement soumis au contexte économique (moral des ménages).
·
le diplôme le plus élevé obtenu est :
o
le CAP ou le BEP pour le tiers des salariés,
o
le brevet professionnel et le bac professionnel pour15% des
salariés,
o
le BTS pour 12% des salariés.
·
La proportion des autodidactes, sans formation initiale est de
29% des salariés.
·
L ‘analyse des résultats selon la taille des entreprises ne
fait pas apparaître de différences véritablement significatives;
·
22% des salariés ont bénéficié d’une formation professionnelle
continue en 2001 et 72% des chefs d’entreprise estiment que les formations
dispensées sont plutôt adaptées.
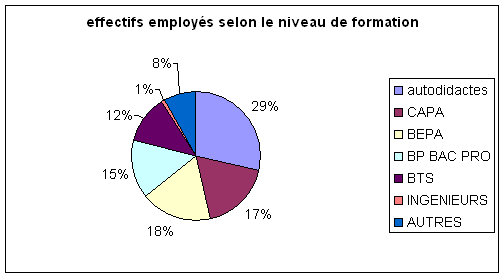
·
Le taux d’encadrement de la profession s’élève à 10%.
·
Le personnel d’encadrement est peu important, de l’ordre de 1/5
pour les entreprises de moins de cinq salariés.
?IDEES-FORCES
·
Début 2002 les effectifs employés dans la filière paysage se
composaient au niveau national (55300 personnes) de la manière suivante:
o
78% d’emplois salariés,
o
22% d’emplois non salariés.
·
La forte saisonnalité de la profession a pour conséquence directe
sur la main-d’œuvre :
o
d’employer d’une part de nombreux saisonniers,
o
d’avoir recours d’autre part à des emplois partiels.
Exemple d’organigramme d’une entreprise paysagiste
·
Plus de 90% des salariés de la profession travaillent à temps
plein.
·
Plus de 45% des chefs d’entreprise mariés emploient leur conjoint
dans leur entreprise.13% de ces derniers y sont salariés et 33%non salariés.
·
Les salariés présents depuis moins de 5 ans représentent 56% de
l’effectif total au niveau national.
NOMBRE D’ACTIFS SELON LA TAILLE DE L’ENTREPRISE
|
|
0 salarié
|
1 à 5 salariés
|
6 à14 salariés
|
plus de 14 salariés
|
ensemble
|
|
salariés
|
|
67%
|
93%
|
98%
|
78%
|
|
non salariés
|
100%
|
33%
|
7%
|
2%
|
22%
|
|
ensemble
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
·
La profession présente un taux de féminisation assez faible :
11%
·
La profession présente un salariat relativement jeune :
l’âge moyen est légèrement supérieur à 33ans.
·
Cette jeunesse s’explique :
o
pour partie par le développement récent de la branche,
o
pour partie par un turn-over important,
o
pour partie par l’arrivée sur le marché de jeunes formés et
diplômés, ayant acquis une spécificité technique (la profession recherche plus
des techniciens que des manœuvres).
·
Une autre particularité de la branche est le fort taux
d’apprentis sous contrat.
?IDEES-FORCES
Comparaison entre CDD et CDI par groupements d’OTEX
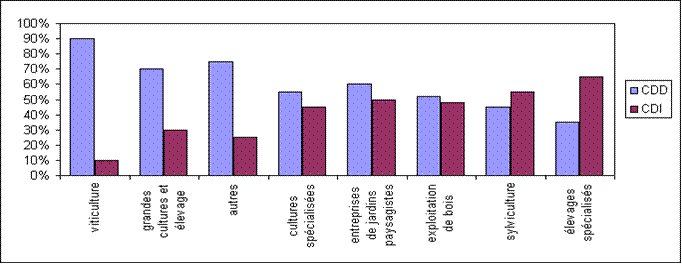
·
Au niveau national 73% des salariés sont employés en CDI.
·
A noter, que 6% des effectifs des collectivités territoriales de
Bourgogne travaillent dans les espaces verts (travaux paysagers compris).
·
Au niveau national, les embauches effectuées concernent :
o
38% de salariés sans formation initiale,
o
Contre 15% pour les CAP,
o
et 13% pour les BEP.
·
Les principaux métiers:les ouvriers paysagistes constituent
l’essentiel des emplois.
Le paysage est un produit de consommation auquel doivent répondre
des salariés créatifs, bons techniciens et à l’écoute des clients.
Personnel de
chantier
v
L’ouvrier paysagiste :
Ø
Il réalise des opérations de création ou d’aménagement de
l’espace vert à partir des plans de travaux transmis :
§
Il prépare les sols,
§
Il procède à l’engazonnement,
§
Il installe les équipements (arrosage…) et peut réaliser la
maçonnerie légère (bordures, dalles, pavés…)
Ø
Il réalise des opérations d’entretien de l’espace vert :
§
Il taille les arbres
§
Il effectue l’entretien des surfaces par le binage des massifs,
le ramassage des feuilles, le décapage de la mousse…
§
Il réalise l’entretien des gazons
Ø
Il peut être amené à conduire des engins spécifiques (tractopelle…).
Ø
L’ouvrier paysagiste réalise ses activités dans le cadre d’une
entreprise du paysage ou d’une collectivité territoriale.. Il exerce sous
l’autorité d’un chef d’équipe, d’un conducteur de travaux ou directement d’un
chef d’entreprise.
Ø
SA FORMATION :
§
CAPA/BEPA travaux paysagers ou aménagements paysagers ou
entretien de l’espace rural ou entretien et aménagement des espaces naturels
et ruraux
§
Bac professionnel agricole travaux paysagers ou aménagements
paysagers, Bac Techno STAE
§
BTSA travaux paysagers ou aménagements paysagers
v
L’élagueur:
Ø
Il organise ses interventions sur le chantier :
§
Il repère l’arbre sur lequel il doit opérer
§
Il établit un mode opératoire ðIl
taille les arbres en respectant les techniques et les conditions de sécurité
§
Il apporte également des soins aux arbres, il peut être amené à
pratiquer l’abattage ou la consolidation.
Ø
L’élagueur travaille dans une entreprise spécialisée en élagage
ou dans une collectivité territoriale ;
Ø
SA FORMATION :
§
Certificat de spécialisation taille et soins aux arbres
§
Certificat de spécialisation Gestion arbres d’ornement
v
Le maçon du paysage :
Ø
Il assure les travaux préparatoires aux constructions paysagères
§
Il réalise les terrassements et la transformation de terrains
§
Il met en place le système d’assainissement et d’arrosage
Ø
Il assure les travaux de construction paysagère :
§
Il construit les murets et les escaliers paysagers, les allées de
circulation, il met en place les bassins, il met en place les systèmes
d’éclairage
Ø
Il peut être amené à participer à l’organisation des chantiers et
à encadrer une équipe.
Ø
SA FORMATION :
§
CAPA/BEPA Travaux paysagers ou aménagements paysagers
§
Bac professionnel agricole travaux paysagers ou aménagements
paysagers, Bac techno STAE
§
BTSA travaux paysagers ou aménagements paysagers
§
certificat de spécialisation constructions paysagères
v
Le chef d’équipe paysagiste
Ø
Il organise et supervise les travaux du personnel sur un chantier
de création, d’aménagement ou d’entretien d’un espace vert.
§
Il interprète les plans d’exécution dans le respect des règles de
sécurité,
§
Il répartit les tâches et donne ses consignes pour leur
accomplissement, transmet son expérience et ses connaissances techniques aux
ouvriers
§
Il contrôle les fournitures, la qualité des végétaux et transmet
les besoins en approvisionnement du chantier
§
Il établit quotidiennement les rapports et participe à la
préparation de la facturation, il élabore les documents analytiques du chantier
Ø
Il participe à l’exécution des travaux paysagers.
Ø
Il peut être amené à apporter des conseils sur le choix et
l’entretien des végétaux, en complément du chef d’entreprise.
Ø
SA FORMATION :
§
Bac professionnel agricole travaux paysagers ou aménagements
paysagers
§
Bac techno STAE, spécialité Technologie des aménagements
§
BTSA travaux paysagers ou aménagements paysagers
v
Le paysagiste d’intérieur :
Ø
Il organise ses interventions :
§
Il prépare les équipements nécessaires en fonction des travaux à
mener
Ø
Il réalise des prestations d’entretien ou de « maintenance ».
§
Il procède au nettoyage des plantes et pulvérise des produits
lustrant sur les plantes
§
Il remplace les plantes abîmées, applique les tuteurs et taille
les végétaux, il applique les produits phytosanitaires avec précaution
Ø
Il réalise les prestations de création.
Ø
Il réalise également l’entretien des plantes stockées dans les
serres de son entreprise dans l’attente de leur utilisation, il procède aux
achats de végétaux auprès des fournisseurs et réceptionne les produits
commandés.
Ø
SA FORMATION :
§
CAPA/BEPA horticulture, production florales et légumières
§
Bac professionnel agricole horticulture, productions florales et
légumières
§
BTSA horticulture, production florale et légumières
§
Certificat professionnel de technicien paysagiste d’intérieur.
v
Le concepteur du paysage :
Ø
il réalise les études et prépare leur mise en œuvre
§
il recueille les informations nécessaires à la compréhension de
l’étude
§
il cerne la demande du client à partir de ses attentes, de son
cadre de vie
§
Pour une commande publique, il prend connaissance de l’appel
d’offre de la collectivité et procède notamment aux relevés topographiques pour
préparer sa candidature
§
il réalise l’analyse paysagère des sites afin de réaliser un
diagnostic et dégage les possibilités techniques les plus adaptées
§
il définit et réalise les documents de présentation des
pré-projets et des projets finalisés, sous forme d’images et textes
Ø
Il gère les fichiers nécessaires aux missions de maîtrise
d’œuvre.
§
Il élabore les pièces administratives utiles au projet
§
Il précise les pièces techniques nécessaires au projet (plans
techniques des terrassements…)
Ø
Il vérifie l’adéquation entre les réalisations et le projet et si
nécessaire, actualise les plans selon les besoins du chantier.
Ø
SA FORMATION :
§
BTSA travaux paysagers ou aménagements paysagers
§
école d’architecture paysagère
§
école d’ingénieur des travaux paysagers
L’évolution de l’entrée sur
le marché du travail des jeunes diplômés de Travaux Paysagers
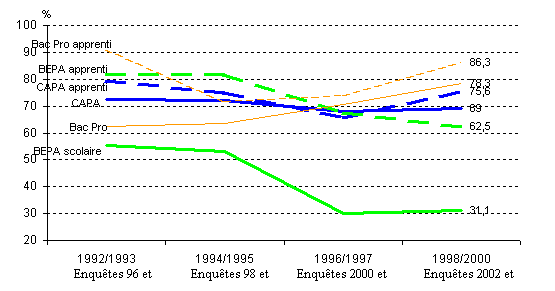
Source : Enquêtes
devenir
Orientation formation et insertion professionnelle des
jeunes de la filière travaux paysagers document intermédiaire sept 2004 M
Bargeot, N Droyer, C Rossand, ENESAD, UNEP, Ministère de l’agriculture
Participants :
AARABI Mohamed (EPL Quétigny)
ANCERY Jacques (CFPPA Quétigny)
BERTHAUD Claude (EPL Quétigny)
BONNARDOT Emmanuel (CA 21)
BOULARD Jean-Luc (Mairie de Sens, MFR Gron)
BOUTHRAY Pierre (Mairie de Châlon)
CHARPY Denis (Mairie de Monéteau)
CHIGNARDET Jean-Pierre (MFR Gron)
CONTENT Gérard (Mairie d’Autun)
CREUZENET Jean-Pierre (Mairie de Châlon)
DORMOY Fleur (APECITA)
GESUATI Jean- Louis (DRAF/SRFD)
HUEBER Robert (Paysagiste - UNEP)
LEMOINE Jean-Pierre (DRAF/SRFD)
LOTTE Dominique (CFA 71)
MAITRE Michel (EPL Tournus)
MALUCHZINSKI Serge (Mairie d’Autun)
MARMUSE Stéphane (CFA Quétigny)
MATRAN Christophe (Legta Quétigny)
MUGNIER Luc (Paysagiste – Paysages 2000)
NIGAY Eric (CFPPA Charolles)
PARIS Claire (C2R)
PERDREAU Jean-Paul (DRAF/SRFD)
ROSSAND Carine (ENESAD)
ROUSSON Jean-Paul (CFA 89)
Excusés :
ADNET Nathalie (CA89)
BAK Hervé (Lycée horticole de Varzy)
BARTHEL Denis (FAFSEA)
CHAMBON Roland (DRAF-SRFD)
DEGUEURCE Dominique (DRAF-SRSA)
DUPIN Denis (EPL Quétigny)
FOIN Michel (DRAF-SRSA)
GUIGNARD Elise (UNEP Bourgogne – Franche Comté)
HURE Marcel (CA 89)
Rappel des principaux points abordés :
Le
contexte du PREAB : cadre institutionnel et réglementaire ;
calendrier de travail jusqu’en juillet 2005 (document remis)
Présentation
d’éléments d’information sur le secteur des travaux paysagers (document présenté
et remis) :
·
Contexte régional ;
·
Positionnement économique du
secteur des travaux paysagers ;
·
Le niveau de qualification des
emplois dans le domaine des travaux paysagers ;
·
L’emploi et l’organisation du
travail dans le domaine des TP ;
·
Les emplois et les principaux
métiers dans le secteur de TP
Présentation
de l’offre de formation et de son évolution entre 2001 et 2005 dans le secteur
des travaux paysagers.
Objectif de cette réunion :
Débattre
et échanger sur la problématique « emploi-formation-qualification-compétences »
dans le secteur des travaux paysagers en vue d’éclairer le groupe de travail et
le comité de pilotage du PREAB sur les principaux constats à effectuer et sur
les principales orientations à prendre par l’enseignement agricole de Bourgogne,
dans ce secteur, entre 2005 et 2009, en termes :
·
De promotion des métiers de
l’horticulture
·
De niveaux de formation et de
qualification,
·
De nombre de formés,
·
D’évolution complémentaires des
voies de formation ( initiale scolaire ; initiale apprentissage ;
formation professionnelle continue)
·
De répartition territoriale de
l’offre de formation sous ses différents aspects
Constats repris et/ou développés lors de la réunion:
·
L’emploi est régi par une
convention collective qui semble appliquée;
·
Peu de hiérarchie des salaires
en fonction des diplômes ;
·
Risque de pénurie de main
d’œuvre dans les dix ans ;
·
Turn - over très important dans
les entreprises ;
·
Très faible féminisation des
emplois au niveau V et IV…un peu plus au niveau III
·
Les entreprises demande à la
fois plus de polyvalence mais il y a aussi des besoins de spécialisation ;
·
Emergence de nouveaux
métiers : paysagisme d’intérieur ; arboriste…
·
Nouvelles exigences techniques :
conduite d’engins, arrosage intégré….
·
Evolution de la demande sociale
/ aux activités du paysage ;
·
On constate une augmentation de
la diversité des expériences professionnelles ( ?) ;
·
Connaissance insuffisante des
métiers du paysage et des entreprises de ce secteur par les enseignants et
formateurs ;
Propositions en termes d’orientations à prendre :
·
Renforcer l’identification des
métiers et améliorer leur connaissance, leur image et leur promotion ;
·
Augmenter le nombre de femmes
dans les entreprises ;
·
Renforcer l’information des
jeunes, des familles, des personnels de l’enseignement sur ce secteur et
ses métiers;
·
Mettre le projet professionnel
du jeune au cœur du dispositif ;
·
Renforcer la connaissance pour
les enseignants et les formateurs des entreprises du paysage et des métiers de
ce secteur ( et de leur évolution) : rencontres avec la profession ,
formation de formateurs en entreprises…
·
Traduire ces orientations dans
une déclinaison régionale de la convention nationale MAPAAR-UNEP
Constats repris et/ou développés lors de la réunion:
·
Quel que soit le diplôme obtenu
l’employabilité reste à renforcer ; la formation en entreprise est
importante ;
·
Le bac professionnel est un bon
diplôme bien adapté aux besoins des entreprises, c’est celui qui est le plus
demandé par elles ; il permet d’accéder plus rapidement à des postes à
responsabilité ;
·
Les bacs professionnels
s’insèrent mieux que les CAPA ;
o Augmentation des exigences en matière de CAO
(conception assistée par ordinateur) et DAO (dessin assisté par
ordinateur) ;
·
Les étudiants de BTSA Aménagements paysagers deviennent
entrepreneurs paysagistes ou occupent une profession intermédiaire en lien avec
leur formation (responsable dans une entreprise paysagiste ou au service espace
vert d’une municipalité, technicien expérimentateur, technicien conseil ou
travaillant en bureau d’études, etc.…) : ces emplois concernent plus de 2
diplômés du BTSA AP sur 5, 1 sur 3 environ travaille comme ouvrier paysagiste, les
autres sont sur des emplois sans lien avec la spécialité aménagements
paysagers.
·
Les étudiants en BTS recherche de plus en plus la possibilité de
poursuivre en licence professionnelle ;
·
Les CAPA restent des publics majoritairement en difficultés, ils sont
plus difficiles à insérer mais ce diplôme reste très utile pour permettre
l’accès à la qualification ;
·
Insuffisance de la formation en matière de conduite d’engins
« espaces- verts » (mini pelles…)
·
Les MAR ou UCARE ne sont pas valorisables en CACES ;
·
Publics niveaux V peu mobiles
Propositions en termes d’orientations à prendre :
·
Etre plus réactif pour s’adapter
à l’évolution de la demande du secteur ;
·
Savoir adapter le contenu de
l’offre de formation ;
·
Prendre en compte le potentiel
offert par la FPC ;
·
Privilégier le parcours BEPA-Bac
professionnel mais travailler davantage l’orientation et la remise à
niveau ;
·
Travailler à la remise à niveau
des bacs profs pour l’accès au BTSA ;
·
Conduire des travaux
d’ingénierie en lien avec la profession pour éviter ou pour combler les
décalages entre l’offre de formation et l’évolution des métiers ;
·
Mettre en œuvre le CACES ;
·
Traduire ces orientations dans
une déclinaison régionale de la convention nationale MAPAAR-UNEP
Constats repris et/ou développés lors de la réunion:
·
Le nombre de formés doit prendre
en compte la perspective de pénurie de main d’œuvre à l’horizon 2010;
·
Avec le développement du
parcours BEPA-Bac prof, le BEPA par la voie scolaire semble mieux adapté dans
la perspective d’une poursuite d’étude du bac prof vers le BTSA;
·
Le BTSA par l’apprentissage
semble bien adapté;
Propositions en termes d’orientations à prendre :
·
Favoriser l’accès des jeunes
filles dans les formations ;
·
Equilibrer l’offre de formation
BEPA entre la voie scolaire et l’apprentissage
·
Développer la formation
professionnelle continue en veillant aux complémentarités entre l’offre
diplômante et l’offre de branche (CQP) ; favoriser les parcours qualifiants
individualisés en valorisant davantage les stages courts ;
·
Favoriser l’accès à la VAE pour
tous et particulièrement pour les publics sans qualification dans le secteur
(près de 30 % des salariés).
Constats repris et/ou développés lors de la réunion:
|
Département
|
Type de formation
|
CAPA
|
BEPA
|
BAC PROF
|
BTSA
|
BPA
2003
|
BP
2003
|
|
21
|
FIS public
|
|
|
|
45
|
|
|
|
FIS privé
|
|
|
|
|
|
|
|
App public
|
44
|
78
|
74
|
|
|
|
|
App prive
|
|
|
|
|
|
|
|
FPC public
|
|
|
|
|
11081 h
|
12104 h
|
|
FPC privé
|
|
|
|
|
|
|
|
Département
|
Type de formation
|
CAPA
|
BEPA
|
BAC PROF
|
BTSA
|
|
58
|
FIS public
|
|
|
23
|
|
|
FIS privé
|
|
31
|
25
|
|
|
App public
|
17
|
14
|
17
|
10
|
|
App prive
|
|
|
|
|
|
FPC public
|
|
|
|
|
|
Département
|
Type de formation
|
CAPA
|
BEPA
|
BAC PROF
|
BTSA
|
|
71
|
FIS public
|
|
?
|
44
|
|
|
FIS privé
|
|
|
|
|
|
App public
|
40
|
46
|
|
28
|
|
Département
|
Type de formation
|
CAPA
|
BEPA
|
BAC PROF
|
BTSA
|
|
89
|
FIS public
|
|
|
|
|
|
FIS privé
|
|
46
|
32
|
23
|
|
App public
|
12
|
|
|
|
L’offre CAPA et BEPA est assez bien repartie ;
la formation professionnelle continue est concentree sur la Côte d’Or malgré un
BP (apprentissage) au CFA de Champignelles (89) ;
Pas de Bac Pro par apprentissage en Saone et Loire.
Propositions en termes d’orientations à prendre :
·
Conforter les établissements
référents et les équipements technologiques qui s’y rattachent;
·
Renforcer territorialement
l’offre en FPC ;
·
Equilibrer territorialement
l’offre de niveau IV en apprentissage ;
SECTEUR
SERVICES EN MILIEU RURAL
Groupe de travail du 22 mars 2005
PREAB 2005/2009
PLAN
I/ Le positionnement
économique du secteur
II/ Le niveau de
qualification des emplois du secteur
III/
L’emploi et l’organisation du travail
IV/ Les emplois et les
principaux métiers du secteur
Participants
ALEXANDRE Jean-Claude (MFR Agencourt)
ASLAN Isabelle (CFPPA Châtillon)
BROCHOT Jean-Marc (DRAF SRFD)
BRONIAR Geneviève (groupe CRIFAD)
CANIOU Joel (chambre d’agriculture)
CHAMBON Roland (DRAF SRFD)
CHIABODO Catherine (LPRP Sainte Colombe)
DERAIN Janine (MFREO La Clayette)
FAVRE Marie-Ange (MFR Quetigny)
FAURE Charlotte (CFPPA du Morvan)
GESUATI Jean-Louis (DRAF SRFD)
GOEBEL Marie-Thérèse (LPA Plagny)
GOUGEON Marie-Claire (LEAP AM Javouhey)
HUBERT Thierry (MFR Quetigny)
HUGOT Béatrice (MFR Baigneux les juifs)
KRZYZOSIAK Manuel (LPP Sainte Marguerite)
LANDELAMY Ingrid (fédération ADMR Côte d’Or)
LORIOT Yvette (URASSAD Bourgogne)
MAYE Joseph (LPA Plagny)
PATEY Delphine (DRAF SRFD)
PERDREAU Jean-Paul (DRAF SRFD)
PERRIER Dominique (C2R Bourgogne)
PINARD Christophe (LPA Champs sur Yonne)
ROSSAND Carine (ENESAD)
SAUNIER Bernadette (LPA CFPPA Charolles)
TREBOZ Jean-Paul (chambre d’agriculture Saône-et –Loire)
Les principaux points abordés :
- le contexte du PREAB : cadre institutionnel et réglementaire ;
calendrier de travail jusqu’en juillet 2005 (document remis )
-présentation d’éléments d’information sur le secteur « services
aux personnes»( document présenté et remis) :
·
contexte régional ;
·
positionnement économique du
secteur « services aux personnes »;
·
le niveau de qualification des
emplois dans le domaine « services aux personnes»;
·
l’emploi et l’organisation du
travail dans le domaine «services aux personnes»;
·
les emplois et les principaux
métiers dans le secteur « services aux personnes »
-présentation
de l’offre de formation et de son évolution entre 2001 et 2005 dans le secteur
« services aux personnes».
Objectif de cette réunion :
Débattre
et échanger sur la problématique
« emploi-formation-qualification-compétences » dans le secteur
« services aux personnes» en vue d’éclairer le groupe de travail et le
comité de pilotage du PREAB sur les principaux constats à effectuer et sur les
principales orientations à prendre par l’enseignement agricole de Bourgogne,
dans ce secteur, entre 2005 et 2009, en terme :
·
de promotion des métiers du
secteur services aux personnes
·
de niveaux de formation et de
qualification,
·
de nombre de formés,
·
d’évolution complémentaires des
voies de formation ( initiale scolaire ; initiale apprentissage ;
formation professionnelle continue)
·
de répartition territoriale de
l’offre de formation sous ses différents aspects
Positionnement économique du secteur
L’enseignement
agricole vise le développement des services aux personnes en milieu rural,
beaucoup de besoins restent encore insatisfaits, mais la question de savoir si
les personnes auront les moyens de payer ces services se pose. Le plan Borloo
devrait permettre d’aider au financement de ces nouveaux emplois.
Constats repris et/ou développés lors de la réunion:
ü Le plan Borloo devrait permettre de financer les
nouveaux emplois dans les services en milieu rural (ces emplois sont par
ailleurs actuellement financés par le Conseil Général dans le cadre de l’APA,
les Caisses de Retraite, les Mutuelles, les différentes aides aux familles…)
ü On constate un manque de lisibilité entre la
diversité des diplômes des différents ministères et celle des métiers.
ü Le secteur des services est porteur en terme
d’emplois mais des doutes subsistent sur la solvabilité de ces emplois.
ü La professionnalisation doit être reconnue.
ü Les emplois sont essentiellement portés par des
structures associatives, mais des initiatives privées se développent (exemple
de la SOFRASAD)
Propositions en terme d’orientations à prendre :
ü Retravailler à la lisibilité des diplômes par
rapport aux métiers.
ü Poursuivre la contribution de l’enseignement
agricole à la professionnalisation. Il faut continuer à professionnaliser les
jeunes : 16% des jeunes de moins de 20 ans sont sans diplôme en Bourgogne.
ü Il faut embaucher prioritairement des personnes de
niveau V et IV, il faut également augmenter les structures d’encadrement et
donc former et embaucher aussi des techniciens supérieurs.
Constats repris et/ou développés lors de la réunion:
ü Plusieurs niveaux de diplôme sont proposés par le
ministère de l’Agriculture : le niveau V CAPA BEPA SMR, le niveau IV BAC
PRO, le niveau III BTSA « services en espace rural » (qui n’existe pas
encore en Bourgogne).
ü Il existe en Côte d’Or et en Saône -et- Loire une
SIL (spécialisation d’initiative locale de niveau V « Aide aux Personnes
Agées et ou Handicapées à Domicile », très professionnalisante mais non
diplômante, cela pose le problème de la non reconnaissance des stagiaires au
niveau des grilles salariales. Se pose la question du devenir de cette
formation, faut-il revenir à un CAPA SMR ou à une autre possibilité que la
SIL ?
ü Les diplômes du ministère de l’agriculture sont mal
reconnus dans les conventions collectives des branches professionnelles
(contrairement à ceux de l’EN). Le ministère des affaires sociales est en train
de reconnaître les diplômes du ministère de l’agriculture. La régionalisation
favorise cela.
ü Il est important de souligner la difficulté de la
reconnaissance des diplômes du ministère de l’agriculture pour passer certains
concours comme aide soignante, assistante sociale… Le BTA n’était bien souvent
pas considéré comme un BAC
ü D’autre part, selon les écoles la reconnaissance des
diplômes n’est pas identique sur le terrain. Ainsi l’IRTESS en Bourgogne
accepte que les élèves ayant un BTSA SMR se présentent au concours d’entrée à
l’école d’assistante sociale alors qu’en Rhône-Alpes, il y a refus.
ü On constate un manque de lisibilité entre la
diversité des diplômes des différents ministères et celle des métiers.
Propositions en terme d’orientations à prendre :
ü Les formations courtes ont tout leur sens, mais il
est quand même souhaitable qu’un grand nombre ait le DEAVS; il faut des
personnes professionnalisées et diplômées.
ü Nécessité de faire reconnaître par les branches
professionnelles, l’enseignement agricole et ses formations dans ce secteur.
ü Il faut continuer à professionnaliser les
jeunes : 16% des jeunes de moins de 20 ans sont sans diplôme en Bourgogne.
ü Retravailler la lisibilité des diplômes par rapport
aux métiers.
ü Renforcer la place de la formation professionnelle
continue dans ce secteur.
Constats repris et/ou développés lors de la réunion:
ü La VAE permet à des personnes travaillant comme aide
à domicile d’obtenir le DAEVS (diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale et
Familiale), le DEAVS par la VAE est mis en place en Bourgogne :
o 616 personnes se sont présentées en 2003 2004 ,
201 personnes ont eu le diplôme dans sa totalité après présentation devant le
jury, 241 personnes ont suivi un parcours de formation, aujourd’hui 59
personnes sont diplômées par module.
o L’origine de ces personnes beaucoup d’aides à
domicile, de personnes travaillant dans les établissements et de plus en plus
de personnes travaillant chez des particuliers.
o Les stagiaires en formation : beaucoup de CAP
et BEP , mais peu de BEP « carrières sanitaires et sociales »
(hypothèse : peut-être sont-elles plus jeunes et n’ont pas encore les 3
années nécessaires pour prétendre à la VAE).
o A noter le manque de tuteurs pour encadrer les
stagiaires.
ü L’offre de formation en Côte d’Or semble suffisante
ü Les formations services aux personnes de
l’enseignement agricole sont bien présentes en formation scolaire et peu en
formation continue, et très peu en apprentissage.
ü L’apprentissage est difficile à mettre en œuvre dans
le secteur de l’aide à domicile, c’est un secteur pour lequel il faut
travailler chez des gens qui ont besoin d’aide régulièrement, et le travail est
souvent à temps partiel.
ü Le schéma régional des formations sociales sera
élaboré. Celui en cours arrive à son terme.
Propositions en terme d’orientations à prendre :
ü Il faut former les jeunes en formation initiale et
seulement ensuite répondre par la formation professionnelle continue pour les
personnes en emploi.
ü Se repositionner sur l’ensemble des voies de
formation dont l’apprentissage et la FPC.
ü Le secteur des services sera conforté en terme de
filière mais pas surdéveloppé (pas d’ouverture de nouvelles filières sans un
solide rapport d’opportunité.
ü Raisonner l’évolution quantitative en formation
professionnelle continue, à partir d’une approche territoriale et partenariale
(CRIFAD, AFPA, CFPPA, GRETA).
ü Poursuivre l’évolution qualitative de l’offre de
formation dans le secteur des services.
ü L’enseignement agricole a toute sa place pour former
les jeunes qui n’ont pas de diplôme (cf loi Borloo)
ü Comment prendre des orientations dans le cadre du
PREAB, alors que le schéma des formations sociales n’est pas arrêté ?
D/
Répartition territoriale de l’offre de formation sous ses différents aspects
Constats repris et/ou développés lors de la réunion:
ü L’offre de formation est suffisamment répartie
territorialement entre l’enseignement agricole et l’Education Nationale.
Propositions en terme d’orientations à prendre :
ü Revoir la qualité du contenu des formations et non
la quantité.
ü Etre attentif à un maillage de tout le territoire
rural (même le rural profond) car les diplômés de niveau V et IV sont en
général peu mobiles, et il ne faut pas négliger la dimension sociale des
services à la personne, vécus comme un prolongement des activités agricoles de
certains ménages (les hommes : agriculteurs, les femmes dans les métiers
de services).
ü Négocier la répartition de l’ offre avec les
différents partenaires dont l’Education Nationale.
Nombre de formés et évolution des voies de formation
(initiale scolaire, initiale apprentissage, formation professionnelle continue
(voir informations remises en séance))
Le point sur les
effectifs 2004/2005 et heures-stagiaires 2003 (formation professionnelle continue)
|
|
CAPA SMR
|
BEPA Services aux
personnes
|
BTA commercialisation et
services en milieu rural
|
BTS économie sociale et
familiale
|
APAHD
|
sensibilisation…
|
aide à domicile
|
Conseiller en économie
sociale et familiale
|
|
FIS public 21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIS privé 21
|
23
|
270
|
132
|
|
|
|
|
|
|
FA privé 21
|
|
|
|
9
|
|
|
|
|
|
FC 21
|
|
|
|
|
6762 HS
|
|
|
68 256 HS
|
|
FIS public 89
|
30
|
74
|
68
|
|
|
|
|
|
|
FIS privé 89
|
51
|
130
|
185
|
35
|
|
|
|
|
|
FA privé 89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FC 89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIS public 71
|
|
32
|
|
|
|
|
|
|
|
FIS privé 71
|
21
|
233
|
56
|
MACON
|
|
|
|
|
|
FA privé 71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FC 71
|
|
|
|
|
6840 HS
|
|
3780 HS
|
|
|
FIS public 58
|
|
61
|
40
|
|
|
|
|
|
|
FIS privé 58
|
|
125
|
41
|
|
|
|
|
|
|
FA privé 58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FC 58
|
|
|
|
|
|
1176 HS
|
|
|
|
|
Groupe de travail du 22 mars 2005
|
|
PREAB 2005/2009
PLAN
1/ Le positionnement économique du
secteur
2/ Le
niveau de qualification des emplois du secteur
3/
Quelques métiers
Eléments de contexte spécifique au secteur du
tourisme :
notre réunion de travail se
situe, alors que :
-
La loi d’orientation agricole de juillet 1999 et les dispositifs de la
loi d’aménagement du territoire (juin 1999) ont pour objectif de développer des
actions de valorisation économique et de mobiliser les ressources du territoire
dans le cadre de contrats de pays, de charte inter-communales…
-
Le schéma régional du tourisme et des loisirs se prépare sous la
responsabilité du conseil régional.
-
La loi relative au développement des territoires ruraux confie à
l’enseignement agricole une mission d’animation et de développement des
territoires,« en effet, les établissements d’enseignement agricole, dont
la moitié se situe dans des communes de moins de 3000 habitants, peuvent jouer
un rôle dans le domaine du développement local de certains territoires.
Véritables ressources d’initiatives locales, les établissements agricoles
pourront ainsi s’affirmer au travers des missions qui leur sont confiées comme
des partenaires privilégiés du développement rural auprès des acteurs
potentiels que sont les communes, les communautés de communes, les pays, les
conseils généraux, les conseils régionaux, les associations et les
professionnels.»
Quelques précisions
La réflexion sur le secteur de référence, implique de
préciser:
La définition d’une entreprise touristique
rurale
L’entreprise
touristique rurale est une très petite entreprise, reposant le plus souvent sur
une structure familiale, occupant en général une à deux personnes.
C’est
une entreprise productrice de biens ou de services, dans laquelle les activités
touristiques représentent environ 50% du temps plein d’une personne;
C’est une entreprise :
·
exprimant un choix de vie, qui articule vie professionnelle et
vie personnelle,
·
inscrite en lien étroit avec le territoire rural, son
environnement, ses potentialités,
·
caractérisée par, en général, la combinaison dans le meilleur des
cas, ou la juxtaposition, d’activités pouvant communément être rattachées à des
filières différentes,
·
ayant eu à réaliser, en général, un fort niveau d’investissements
qui caractérise le secteur du tourisme et de l’accueil.
La définition de l’agritourisme
L’agritourisme
est une activité menée dans une exploitation, par une famille, dans un
territoire.
Dans
les territoires à dominante agricole, l’agritourisme est en situation marginale.
Dans
les territoires émergents en terme d’agritourisme, les initiatives hors normes
foisonnent avec une volonté de valoriser l’agriculture.
Dans
les régions plus touristiques, où l’accueil est une pratique ancienne et
normalisée, la labellisation sert à se démarquer. Ici les agriculteurs sont
entreprenants, indépendants et formés.
?IDEES-FORCES/
/
·
La saisonnalité, les temps partiels, accroissent les difficultés
de création et/ou d’épanouissement de ce secteur économique, dont les activités
ne sont pas toujours perçues et vécues comme des « métiers »
au sens traditionnel du mot.
- Cette forme de tourisme est
caractérisée par son ancrage au territoire: la diversité des
territoires et des potentialités engendre la diversité des situations
professionnelles.
- Les entreprises de tourisme
rural jouent un rôle décisif dans le développement local:
- en matière de création et/ou
de maintien d’emplois sur ces territoires,
- ce sont par définition des
entreprises « indélocalisables »,
- en matière de qualification
des personnes,
- en matière de maintien des
services publics,
- en matière de préservation du
patrimoine,
- en matière de maintien du lien
social…
- La caractéristique du tourisme
rural en Bourgogne reste avant tout son atomisation,
- du fait non seulement de son
nombre important d’acteurs,
- mais aussi de par sa présence
sur la quasi totalité du territoire.
Cet état constitue indéniablement une difficulté quant à la
commercialisation, mais représente également une richesse importante en
permettant de proposer à la clientèle une gamme élargie de produits.
- 20 000 agriculteurs
pratiquent aujourd’hui dans le cadre de leur exploitation une activité
d’agritourisme en France. Cette donnée demeure stable depuis une
quinzaine d’années, malgré une demande de tourisme à la campagne en hausse
et une image très forte.
- Avec plus de 13% de la capacité
totale des hébergements marchands de Bourgogne, dont les trois quart
situés en zone rurale en difficulté, le tourisme rural représente
désormais une activité économique à part entière. La consommation
touristique engendrée par les hébergements ruraux (gîtes, chambres d’hôtes, camping à la ferme,
chalets loisirs, gîtes d’enfants, gîtes de séjour et étapes, fermes auberges),
s’élève en 2003 à 66 millions d’euros. Il y a aujourd’hui plus de 1100
propriétaires bourguignons à s’être diversifiés dans les activités
d’hébergements touristiques. Parmi ces acteurs de la vie économique
touristique, bon nombre sont agriculteurs ou proches du monde agricole.
- Les propriétaires
d’hébergements ruraux sont de plus en plus nombreux à utiliser les
nouvelles technologies de l’information, ces moyens de communication
permettent à des petites structures d’être directement accessibles par l’ensemble
de la clientèle.
- Les nationalités qui pèsent le
plus , à l’échelle du territoire national, dans les séjours des touristes
ruraux sont :les britanniques, les allemands puis les hollandais.
- La Bourgogne n’est pas classée
parmi les régions les plus fréquentées en terme de destination
« campagne » (site www.cp-tourisme-rural.fr).
v
En formation initiale il existe :
Ø
au niveau V :
§
le CAPA SMR ,
§
le BEPA « services spécialité secrétariat accueil »
Ø
au niveau IV :
§
le bac pro « services en milieu rural », mis en œuvre
en septembre 2005, par rénovation du BTA, il vise à former des
« techniciens de services en milieu rural », de niveau IV, qui
exerceront leur activité dans l’ensemble des secteurs couvrant les services de
proximité et garantissant le maintien du lien social en milieu rural. Ce sont
entre autre, les secteurs du tourisme, de l’animation patrimoniale et
culturelle, mais aussi du social, du service à la personne, de la santé, de
l’administration, du commerce, de la production agricole et de l’industrie, du
service au particulier…
Ø
au niveau III :
§
le BTS « services en espace rural » expérimental
dans six établissements,
§
le BTSA « gestion et protection de la nature spécialité
animation nature »
v
En FPC on trouve, entre autre :
Ø
un CS « tourisme vert, accueil et animation en
milieurural »,complémentaire à un diplôme de niveau IV ;
Ø
une SIL « guide de pays »,
Ø
des unités capitalisables « tourisme rural »
associées au BP « responsable d’exploitation agricole » ou au BPA
« ouvrier hautement qualifié ou responsable d’exploitation »,
Ø
des licences professionnelles se développent : à
noter entre autre : « promoteur du patrimoine territorial »
(université de Grenoble EPL Aubenas), « valorisation et médiation des
territoires ruraux » (université Bordeaux, ENITA Bordeaux).
v
Le taux d’accès à la formation professionnelle continue demeure
faible dans les métiers du tourisme rural. L’accès à la formation continue reste
à améliorer :
Ø
Les salariés du tourisme en général rencontrent des difficultés à
se libérer et à se déplacer pour suivre un cycle de formation continue, ainsi
par exemple, les calendriers et programmations des formations sont inadaptés à
la saisonnalité de cette activité.
Ø
Quand un salarié effectue différents métiers sous différents
statuts, se pose également le problème de cotisations à des structures
différentes ouvrant des droits à la formation : un droit à la FPC pour le
« pluriactif » et le saisonnier en mutualisant les droits acquis
reste à créer.
v
Un certain nombre de porteurs de projets et d’acteurs de tourisme
rural n’ont pas toujours suivi une formation initiale avec une spécialisation
dans le tourisme.
v
L’individualisation et l’adaptation aux territoires des
formations en tourisme rural sont des orientations importantes. Ceci nécessite
des formations modulaires, des suivis individualisés.
v
La combinaison d’activités, caractéristiques du secteur du
tourisme rural, induit des besoins en pluriformation en lien avec la
problématique « agri-tourisme », relations avec la clientèle.
v
Il existe également des partenariats avec Jeunesse et Sports pour
la formation BAPAAT (brevet d’aptitude professionnel d’ animateur assistant
technicien) , pour la mise en place de BP JEPS, brevet professionnel de la
jeunesse de l’éducation populaire du sport; spécialité « loisirs tous
publics » mais également pour la spécialité « activités équestres et
pêche de loisir » (pour cette dernière
il existe une co-délivrance entre le ministère de la jeunesse et des sports et
le MAAPR) et du BEATEP (brevet d’état d’animateur technicien de
l’éducation populaire).
v
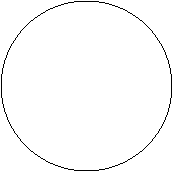 A noter par ailleurs, qu’il existe
au sein de l’enseignement agricole, le réseau « tourisme en milieu
rural » qui regroupe des formateurs, des enseignants, des chercheurs, des
experts… Il est basé au centre national de ressources du tourisme en espace
rural à l’ENITA de Clermont-Ferrand.
A noter par ailleurs, qu’il existe
au sein de l’enseignement agricole, le réseau « tourisme en milieu
rural » qui regroupe des formateurs, des enseignants, des chercheurs, des
experts… Il est basé au centre national de ressources du tourisme en espace
rural à l’ENITA de Clermont-Ferrand.
|
|
Il existe une convention
DRAF DRJS pour renforcer l’offre de formation dans le secteur de l’accueil,
du tourisme et de l’animation
|
|
?IDEES-FORCES
- Il est difficile de réaliser un inventaire des activités
et métiers en tourisme rural :
- Animateur de tourisme rural
- Il fait découvrir les milieux protégés où il travaille,
par des promenades et des expositions…il apprend aux visiteurs, à
respecter la nature, à protéger notre environnement par des gestes
simples.
- Il peut se spécialiser dans un domaine particulier de la
découverte du patrimoine auprès d’un public donné (touristes,
adolescents…) et adapter ses projets d’animation en fonction des
publics.
- Formation : Après un bac professionnel ou technologique,
BEATEP option tourisme et nature en alternance ou un BTSA option gestion
et protection de la nature.
- Accompagnateur de tourisme équestre
il mène les cavaliers amateurs en balade.
- Le gestionnaire de gîtes et de fermes pédagogiques
Le fermier, gestionnaire de gîtes et de fermes pédagogiques, héberge des
personnes afin de leur permettre de découvrir le fonctionnement de son
exploitation et de participer à toutes les activités de la ferme, il doit
posséder des qualités pédagogiques pour pouvoir expliquer à ses
différents publics les activités qu’il exerce, le fermier doit se tenir
au courant des activités touristiques proposées dans sa région afin d’en
informer ses hôtes.
Participants :
BELLET Yann (Comité Régional du Tourisme)
BERTRAND Christine (Communauté de Communes du Pays
Châtillonnais)
BETRANCOURT Chantal (LEGTA Château-Chinon)
BRISOT-HOURS Sylvie (EPLEFPA Semur-Châtillon)
BROCHOT Jean-Marc (DRAF/SRFD)
CAILLOT Dominique (CFPPA du Morvan)
CLAUDIN Jean-Michel (CFPPA EPL des Terres de l’Yonne)
CLERC-LAPREE Fabienne (CFPPA Mâcon-Davayé)
DAUDELIN Stéphane (Pays Auxois Morvan)
DEFRANCE Anne (Conseil Régional Bourogne)
GUYOT Marie-Agnès (CFPPA EPL Beaune Semur Châtillon)
LEBUGLE Philippe (Chambre Agriculture Bourgogne)
MARCILLY Thierry (DRJS Dijon)
MATRAT François (Chambre d’Agriculture Côte d’Or)
PERDREAU Jean-Paul (DRAF/SRFD)
RONDEAU Marie-Jeanne (Chambre d’agriculture Yonne)
THOMAS Nadine ( Chambre d’Agriculture Yonne)
TRELLU Florence (Communauté de Communes du Pays
Châtillonnais)
Rappel des principaux points abordés :
- le contexte du PREAB : cadre institutionnel et
réglementaire ; calendrier de travail jusqu’en juillet 2005 (document
remis )
-présentation d’éléments d’information sur le secteur du tourisme
·
contexte régional ;
·
positionnement économique du
secteur du tourisme
·
le niveau de qualification des
emplois dans le domaine du tourisme
l’emploi et l’organisation du travail dans le domaine du tourisme
les emplois et les principaux métiers dans le secteur du tourisme
-présentation
de l’offre de formation et de son évolution entre 2001 et 2005 dans le secteur
du tourisme .
Objectif de cette réunion :
Débattre
et échanger sur la problématique « emploi-formation-qualification-compétences »
dans le secteur « du tourisme » en vue d’éclairer le groupe de travail et
le comité de pilotage du PREAB sur les principaux constats à effectuer et sur
les principales orientations à prendre par l’enseignement agricole de
Bourgogne, dans ce secteur, entre 2005 et 2009, en termes :
·
de métiers et emplois ;
·
de niveaux de formation et de
qualification,
·
de nombre de formés et
d’évolution complémentaires des voies de formation ( initiale scolaire ;
initiale apprentissage ; formation professionnelle continue) et de
répartition territoriale de l’offre de formation sous ses différents aspects
A/
les métiers et les emplois
Constats :
Dans
ce secteur on parle davantage d’activités que de métiers : faut-il faire
évoluer cette approche?
Les
emplois sont peu définis ;
Le
tourisme se développe du Nord vers le sud de la région ;
Le
référentiel professionnel du bac professionnel Service en Milieu Rural (SMR)
intègre la notion « d’entrepreneur en milieu rural » ;
Les
personnes qui se lancent dans le développement d’activités touristiques en
milieu rural sont biens des entrepreneurs mais avec des compétences
spécifiques ;
Au
niveau de la DRJS on parle davantage d’emplois liés à l’animation centrés sur
les activités sportives et de pleine nature.
Les
travaux conduits par le Conseil Régional en vue de l’élaboration du schéma
régional du tourisme en Bourgogne font ressortir la diversité des activités
touristiques et la complexité des systèmes de formation ; du
tourisme ;
Des
dynamiques locales se mettent en place (exemple de la ferme du Hameau) ;
valoriser
les projets importants existants pour accompagner la dynamique de développement
d’activités ( projet portes de Bourgogne ; projet Alésia…) ;
Les
touristes sont « itinérants et « volatils » : il faut
organiser leur accueil et développer les activités touristiques sur la base de
ce constat tout en favorisant la prolongation des séjours ; il faut
raisonner au-delà d’une échelle territoriale et imaginer des liens entre
territoires, entre réseaux , entre régions…
Orientations à prendre :
Travailler
à la notion de projet de formation lié à un projet d’activités ;
Renforcer
les possibilités de garder les jeunes formés (en particulier au niveau
IV) …quelques pistes : pépinières d’entreprise en milieu rural ;
maison de l’emploi, mise en réseau des grandes et des petites entreprises…
Face
aux difficultés à faire de la prospective chercher à accompagner les acteurs du
tourisme, et plus globalement les créateurs d’activités en milieu rural, à
faire davantage de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences :
y aura-t-il besoin de salariés de haut niveau ? ;
Développer
les perspectives de bi-qualification ;
Valoriser
la mission « animation et développement des territoires » ;
Le
référentiel professionnel du bac professionnel « Services en Milieu
rural » positionne au niveau IV le « technicien de services en milieu
rural »…cela suppose la notion « d’entreprises de services en milieu
rural ». Ces entreprises sont, seront exigeantes en matière de polycompétences :
développer la perspective de portefeuille de compétences .
B/
niveaux de formation et de qualification
Constats :
Difficultés
pour trouver des lieux de stage pour les CAPA SMR ou les BTA ( futurs bac
prof) dans le secteur du tourisme. Interrogation : y a-t-il de réelles
perspectives d’emplois pour les bacs prof SMR ?
Des
dynamiques locales se mettent en place (exemple de la ferme du Hameau) :
fédérer le tourisme sur 9 cantons, perspectives de plan de formation à mettre
en place ;
Difficultés
à faire venir en formation les gestionnaires de gîtes ; comment faire
venir ceux qui en ont besoin ?
Difficultés
à mobiliser les personnes sur des formations longues (manque de disponibilité)
Déficit
de compétences en accueil, langues, NTIC ;
Le
réseau des CFPPA représente une force territoriale pour construire de l’offre
de formation ;
Orientations à prendre :
Adapter
l’offre de formation tant dans ses contenus que dans ses modalités de mise en
œuvre, aux contraintes de personnes adultes ( démarches complémentaires, pas
de possibilité de rémunération…) qui souhaitent la suivre
Renforcer
les compétences en accueil, langues, NTIC ;
Renforcer
le rôle du réseau des CFPPA pour construire de l’offre de formation adaptée aux
caractéristiques des publics et aux exigences territoriales ;
Développer
des journées de sensibilisation plutôt que des formations longues ;
Rechercher de la cohérence avec les fiches actions
–formation des contrats de Pays ;
Développer
des formations pour les propriétaires d’hébergement ;
Développer
les prestations des formation pour les offices de tourisme ;
Nécessité
d’offres locales, courtes fractionnées dans le temps ;
Quels
sont les résultats de l’expérimentation sur le BTSA « Services en Espace
Rural » ;
Quels
positionnement vis à vis des licences professionnelles ? L’offre semble
déjà importante au niveau national : faut-il la développer ? (26
licences prof identifiées le 12/04/05 sur le site du géotourisme « le
site de la géographie touristique en France », dont une en
Bourgogne : licence prof activités sportives, spécialité : métiers
touristiques;
C/
nombre de formés et évolution des voies de formation ( initiale scolaire ;
initiale apprentissage ; formation professionnelle continue et répartition
territoriale de l’offre.
Constats :
Difficultés
à conserver les personnes qui souhaitent faire une spécialisation après BTS
faute d’avoir une offre adaptée ;
Concernant
le CS « ? » : il y a des contradictions entre les objectifs et
les caractéristiques du public qui le suit. Il faudrait pouvoir faire évoluer
les modalités de mise en oeuvre et les modalités de financement ;
Pas
de formation pour les propriétaires d’hébergement ;
Les
actions de formations ne sont pas toujours adaptés aux besoins des
personnes ;
L’effet
d’une formation ne doit pas se mesurer seulement en matière d’insertion mais
aussi pour ce qu’elle apporte en matière de développement du territoire ;
La
spécialité d’initiative local (SIL) « Guide de Pays » doit être
considérée comme un tremplin vers autre chose ( ?)
Quel
est le devenir des personnes qui ont suivi la SIL ?
Orientations à prendre :
Se
rapprocher des acteurs du développement local ;
Tendre
à déployer l’ensemble du dispositif de formation agricole sur l’ensemble du
tourisme…quel que soit le public ; Prendre en compte la ruralité dans sa
globalité ;
Mettre
l’accent sur l’accompagnement des porteurs de projets et sur les acteurs déjà
en activités et qui veulent actualiser leurs connaissances et développer leurs
compétences.
Favoriser
la spécialisation après formation(s) diplômante(s) ;
Développer
des formations qui favorisent l’ancrage territorial ;
EFFECTIFS FORMATION 2004
|
|
CAPA SMR
|
BEPA
|
BTA
|
SIL 2003
|
F Cocher 2003
|
|
FIS public 21
|
|
|
|
|
|
|
FIS privé 21
|
23
|
23
|
132
|
|
|
|
F apprentissage 21
|
|
|
|
|
|
|
F continue 21
|
|
|
|
7385
|
6762
|
|
|
CAPA SMR
|
BEPA
|
BTA
|
SIL
|
F Cocher
|
|
FIS public 71
|
|
7
|
|
|
|
|
FIS privé 71
|
21
|
|
56
|
|
|
|
F apprentissage 71
|
|
|
|
|
|
|
F continue 71
|
|
|
|
3375
|
|
|
|
CAPA SMR
|
BEPA
|
BTA
|
SIL
|
F Cocher
|
|
FIS public 58
|
|
|
40
|
|
|
|
FIS privé 58
|
|
|
41
|
|
|
|
F apprentissage 58
|
|
|
|
|
|
|
F continue 58
|
|
|
|
1368
|
|
|
|
CAPA SMR
|
BEPA
|
BTA
|
SIL
|
F Cocher
|
|
FIS public 89
|
30
|
|
68
|
|
|
|
FIS privé 89
|
51
|
12
|
185
|
|
|
|
F apprentissage 89
|
|
|
|
|
|
|
F continue 89
|
|
|
|
4108
|
|